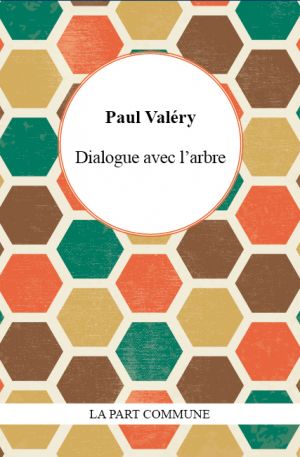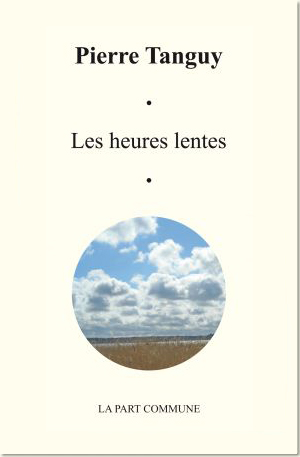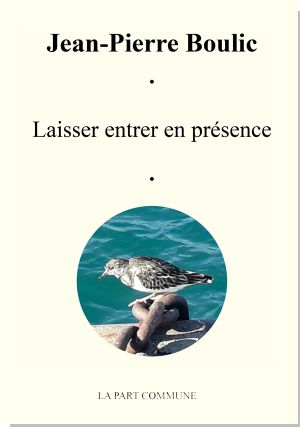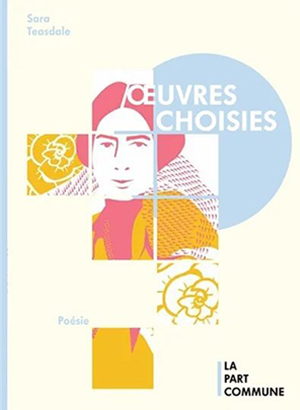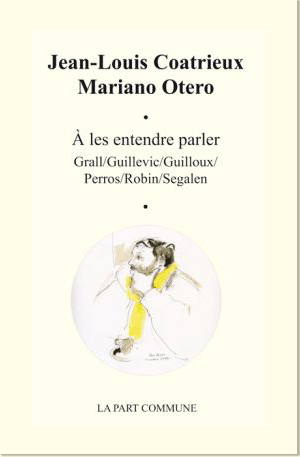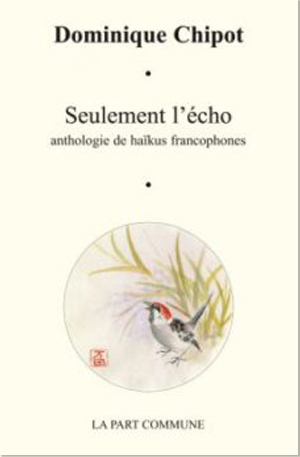Messieurs,
Une certaine circonstance – un hasard, puisque le hasard est à la mode – m’ayant fait revenir, il y a quelque temps, aux Bucoliques de Virgile, (que je n’avais pas revues, je l’avoue, depuis bien des années), ce retour au Collège m’a inspiré d’écrire, comme un devoir d’écolier, la fantaisie en forme de dialogue pastoral dont je vous lirai quelque partie. Des discours, plus ou moins poétiques, consacrés à la gloire d’un Arbre, s’échangent entre un Tityre et un Lucrèce, dont j’ai pris les noms sans les consulter.
lucrèce : Que fais-tu là, Tityre, amant de l’ombre à l’aise sous ce hêtre, à perdre tes regards dans l’or de l’air tissu de feuilles ?
tityre : Je vis. J’attends. Ma flûte est prête entre mes doigts, et je me rends pareil à cette heure admirable. Je veux être instrument de la faveur générale des choses. J’abandonne à la terre tout le poids de mon corps : mes yeux vivent là-haut, dans la masse palpitante de la lumière. Vois, comme l’ARBRE semble au-dessus de nous jouir de la divine ardeur dont il m’abrite : son être en plein désir, qui est certainement d’essence féminine, me demande de lui chanter son nom et de donner figure musicale à la brise qui le pénètre et le tourmente doucement. J’attends mon âme. Attendre est d’un grand prix, Lucrèce. Je sentirai venir l’acte pur de mes lèvres et tout ce que j’ignore encore de moi-même épris du Hêtre va frémir. Ô Lucrèce, est-ce point un miracle, qu’un pâtre, un homme oubliant un troupeau, puisse verser aux cieux la forme fugitive et comme l’idée nue de l’Arbre et de l’instant ?
lucrèce : Il n’est, Tityre, il n’est miracle ni prodige que l’esprit, s’il le veut, ne puisse pas réduire à sa propre énigme naïve… Moi, je pense ton arbre, et le possède à ma façon.
tityre : Mais toi, tu fais profession de comprendre les choses : tu rêves sur ce hêtre d’en savoir beaucoup plus qu’il n’en pourrait savoir lui-même, s’il eût une pensée qui l’induisît à croire se saisir… Moi, je ne veux savoir que mes moments heureux. Mon âme aujourd’hui se fait arbre. Hier, je la sentis source. Demain ?… M’élèverai-je avec la fumée d’un autel, ou tiendrai-je au-dessus des plaines, l’altitude, dans le sentiment de puissance du vautour sur ses lentes ailes, le sais-je ?
lucrèce : Tu n’es donc que métamorphoses, Tityre…
tityre : C’est à toi de le dire. Je te laisse la profondeur. Mais, puisque cette masse d’ombre t’attire comme une île de fraîcheur au milieu du feu de ce jour, arrête et cueille l’instant. Partageons-nous ce bien, et faisons entre nous l’échange de ta connaissance de cet Arbre, avec l’amour et la louange qu’il m’inspire… Je t’aime, l’Arbre vaste, et suis fou de tes membres. Il n’est fleur, il n’est femme, grand Être aux bras multipliés, qui plus que toi m’émeuve et de mon cœur dégage une fureur plus tendre. Tu le sais bien, mon Arbre, que dès l’aube je te viens embrasser : je baise de mes lèvres l’écorce amère et lisse, et je me sens l’enfant de notre même terre. À la plus basse de tes branches, je pends ma ceinture et mon sac. De tes ombres touffues, un gros oiseau soudain s’envole avec fracas et fuit d’entre tes feuilles, épouvanté m’épouvantant. Mais l’écureuil sans peur descend et se hâte vers moi : il vient me reconnaître. Tendrement naît l’aurore, et toute chose se déclare. Chacune dit son nom, car le feu du jour neuf la réveille à son tour. Le vent naissant bruit dans ta haute ramure. Il y place une source, et j’écoute l’air vif. Mais c’est Toi que j’entends. Ô langage confus, langage qui t’agites, je veux fondre toutes tes voix ! Cent mille feuilles mues font ce que le rêveur murmure aux puissances du songe. Je te réponds, mon Arbre, je te parle et te dis mes secrètes pensées. Tout de ma vérité, tout de mes vœux rustiques : tu connais tout de moi et les tourments naïfs de la plus simple vie, la plus proche de toi. Je regarde alentour si nous sommes bien seuls, et je te confie ce que je suis. Tantôt, je me confesse haïssant Galatée ; tantôt, un souvenir me faisant délirer, je te tiens pour son être, et deviens un transport qui veut follement feindre, et joindre et prendre et mordre autre chose qu’un songe : une chose qui vit… Mais, d’autres fois, je te fais dieu. Idole que tu es, ô Hêtre, je te prie. Pourquoi non ? Il y a tant de dieux dans nos campagnes. Il en est de si vils. Mais toi, quand s’apaise
le vent, et que la majesté du Soleil calme, écrase, illumine tout ce qui est dans l’étendue, toi, tu portes sur tes membres divergents, sur tes feuilles innombrables, le poids ardent du mystère de midi ; et le temps tout dormant en toi ne dure que par l’irritante rumeur du peuple des insectes… Alors, tu me parais une sorte de temple, et il ne m’est de peine ni de joie que je ne dédie à ta sublime simplicité.