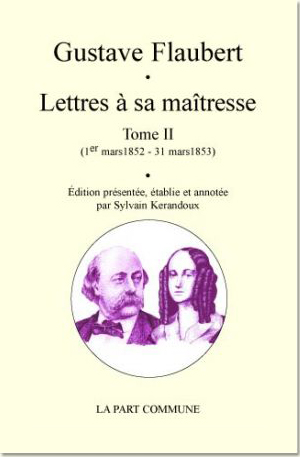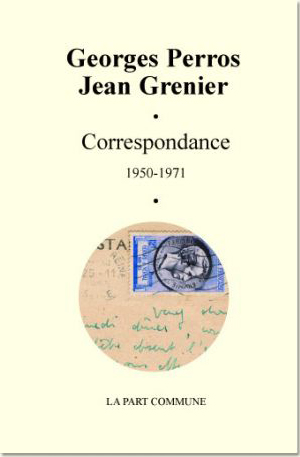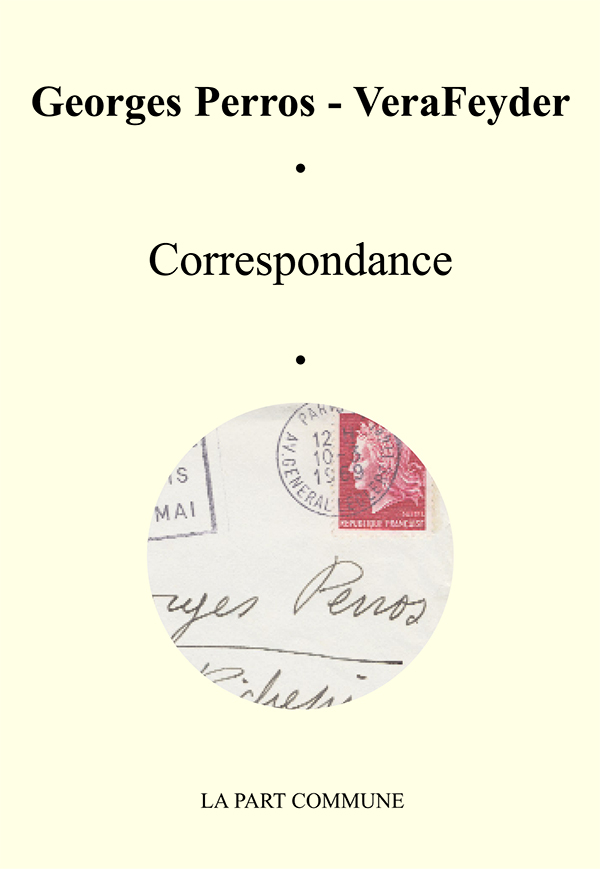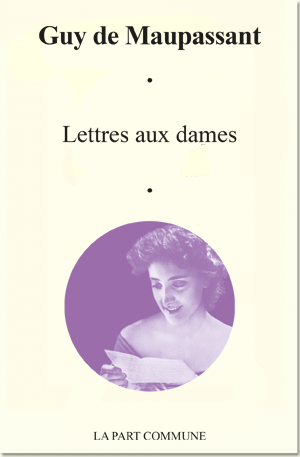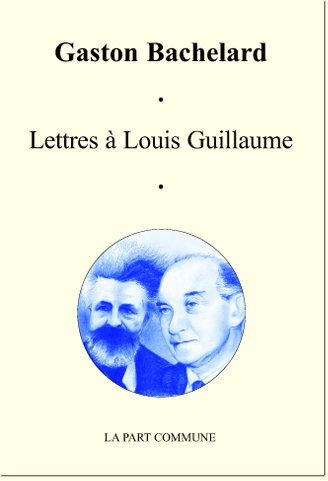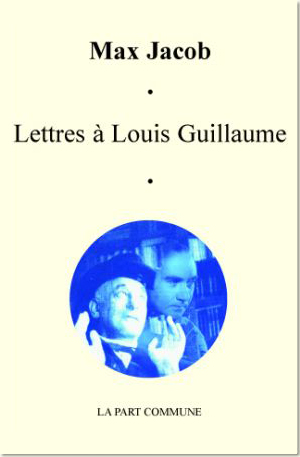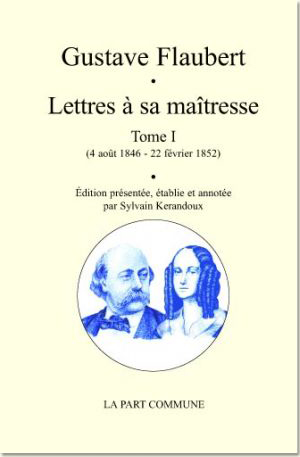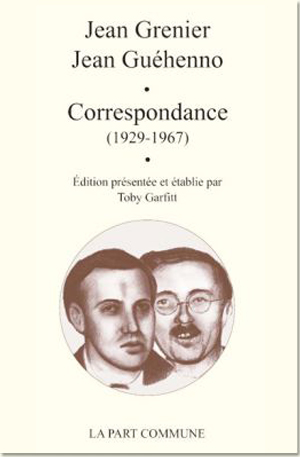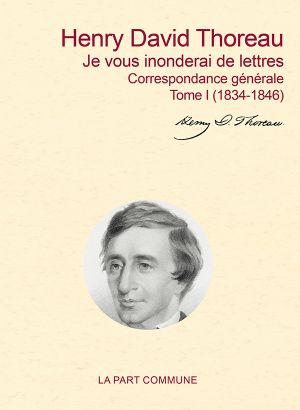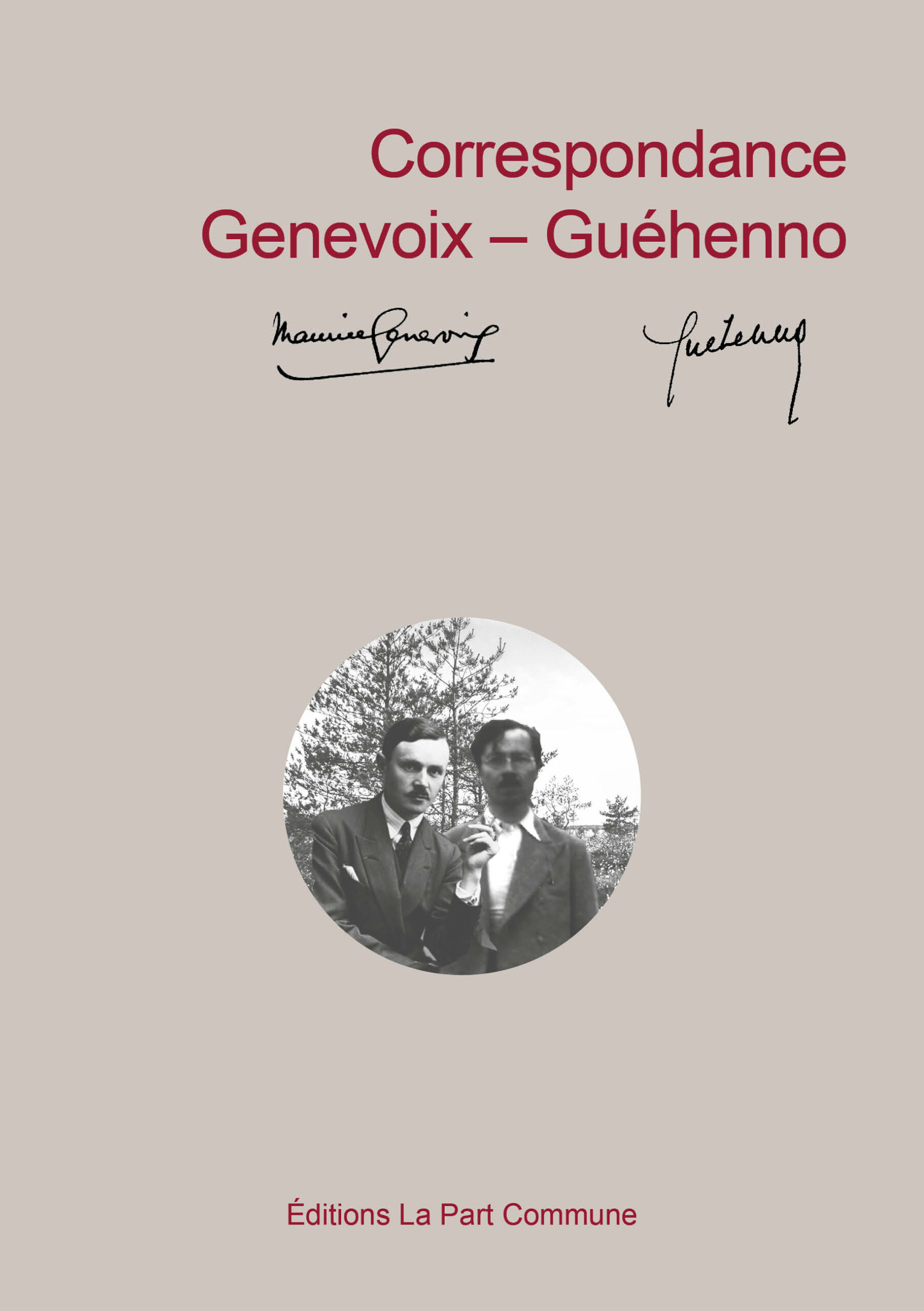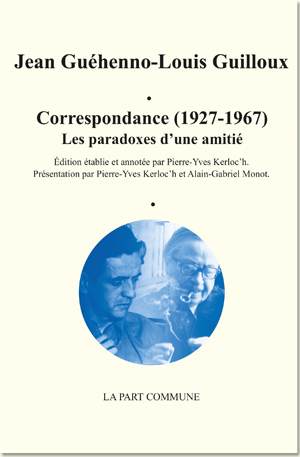Lettre 117
J’ai reçu tantôt un rendez-vous de Duplan (pour la Revue des Deux Mondes) m’indiquant ce soir même à 8 h[eures] ½. Je ne puis par conséquent t’aller voir, chère amie. À demain donc. Je viendrai de bonne heure, vers 4 ou 5 heures et resterai jusqu’au soir.
Le souvenir d’hier ne sera pas des plus mauvais.
Travaille bien ce soir. Que La Muse me remplace, et te serre aussi fort.
Adieu, à demain.
À toi.
g[usta]ve.
*
Lettre 128
[Croisset] Lundi soir, minuit [1er mars 1852].
Chère amie,
Dans huit jours je pense être près de toi. Si tu ne me vois pas chez toi lundi, une fois passé 9 heures, ce sera pour le lendemain mardi. Je resterai jusqu’à la fin de la semaine.
Si tu vois Pelletan, tu peux, de toi-même, lui parler de Melaenis et qu’il fasse un article comme il l’entende, favorable bien entendu. Ce serait ce qu’il y aurait de mieux, puisque c’est lui qui fait les comptes rendus de La Presse. Mais je ne crois pas qu’il se charge de critiquer les vers.
Tâche de me savoir quelque chose quant à l’affaire Sainte-Beuve. Il a paru aujourd’hui dans la Revue de Paris des vers de Bouilhet ; procure-toi ce numéro.
Je suis en train de raboter quelques pages de mon roman pour m’arrêter à un point. Mais ça n’en finit [pas]. Cette première partie, que j’avais estimée devoir être finie à la fin de janvier, me mènera jusqu’à la fin de mai. Je vais si lentement ! Quelques lignes par jour, et encore !
Voilà que je recommence comme du temps de Saint Antoine ; je ne peux plus dormir. Je n’en éprouve aucune fatigue. Une fois que mon horloge [est remontée], elle va longtemps ; mais il ne faut pas qu’on l’arrête. Et pour la remonter, c’est avec des cabestans et des machines. Je ne lis rien, sauf un peu de Bossuet, le soir, dans mon lit ; j’ai quitté momentanément tout pour arriver en temps. Je voulais être libre à l’époque que j’avais dite.
Adieu donc, pauvre cher cœur, à bientôt ; je t’embrasserai effectivement et comme je t’aime, à bras serrés.
À toi.
Lettre 129
[Croisset] Mercredi, 1 heure de nuit [3 mars 1852].
Laisse donc là toutes tes corrections. La chose est risquée : qu’elle le soit ! Merci, merci, pauvre chère femme, de tout ce que tu m’envoies de tendre. Je suis content de moi, de te voir heureuse à mon endroit ; comme je t’embrasserai la semaine prochaine !
Je viens de relire pour mon roman plusieurs livres d’enfant. Je suis à moitié fou, ce soir, de tout ce qui a passé aujourd’hui devant mes yeux, depuis de vieux keepsakes jusqu’à des récits de naufrages et de flibustiers. J’ai retrouvé des vieilles gravures que j’avais coloriées à sept et huit ans et que je n’avais [pas] revues depuis. Il a des rochers peints en bleu et des arbres en vert. J’ai reéprouvé devant quelques-unes (un hibernage dans les glaces entre autres) des terreurs que j’avais eues étant petit. Je voudrais je ne sais quoi pour me distraire ; j’ai presque peur de me coucher. Il y a une histoire de matelots hollandais dans la mer glaciale, avec des ours qui les assaillent dans leur cabane (cette image m’empêchait de dormir autrefois), et des pirates chinois qui pillent un temple à idoles d’or. Mes voyages, mes souvenirs d’enfant, tout se colore l’un de l’autre, se met bout à bout, danse avec de prodigieux flamboiements et monte en spirale.
J’ai lu aujourd’hui deux volumes de Bouilly : pauvre humanité ! Que de bêtises lui sont passées par la cervelle depuis qu’elle existe !
Voilà deux jours que je tâche d’entrer dans des rêves de jeunes filles et que je navigue pour cela dans les océans laiteux de la littérature à castels, troubadours à toques de velours à plumes blanches. Fais-moi penser à te parler de cela. Tu peux me donner là-dessus des détails précis qui me manquent. Adieu, à bientôt donc. Si lundi à 10 heures je ne suis pas chez toi, ce sera pour mardi. Mille baisers.
*
Lettre 130
[Croisset] Nuit de samedi, 1 h[eure, 20 mars 1852].
J’ai été d’abord deux jours sans rien faire, fort ennuyé, fort désœuvré, très, endormi. – Puis j’ai remonté mon horloge à tour de bras, et ma vie maintenant a repris le tic tac de son balancier. J’ai rempoigné cet éternel grec, dont je viendrai à bout dans quelques mois, car je me le suis juré, et mon roman qui sera fini Dieu sait quand. – Il n’y a rien d’effrayant et de consolant à la fois comme une œuvre longue devant soi. On a tant de blocs à remuer, et de si bonnes heures à passer ! – Pour le moment je suis dans les rêves de jeune fille jusqu’au cou. Je suis presque fâché que tu m’aies conseillé de lire les mémoires de Mme Lafarge, car je vais probablement suivre ton avis, et j’ai peur d’être entraîné plus loin que je ne veux. – Toute la valeur de mon livre, s’il en a une, sera d’avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire (que je veux fondre dans une analyse narrative). Quand je pense à ce que ça peut être, j’en ai des éblouissements. Mais lorsque je songe ensuite que tant de beauté m’est confiée – à moi – j’ai des coliques d’épouvante à fuir me cacher n’importe où. Je travaille comme un mulet depuis quinze longues années. J’ai vécu toute ma vie dans cet entêtement de maniaque, à l’exclusion de mes autres passions que j’enfermais dans des cages, et que j’allais voir quelquefois seulement pour me distraire. – Oh ! si je fais jamais une bonne œuvre, je l’aurai bien gagné. Plût à Dieu que le mot impie de Buffon fût vrai, je serais sûr d’être un des premiers.
—–
Il y a aujourd’hui huit jours à cette heure, je m’en allais de toi, gluant d’amour. Comme le temps passe !
Oui, nous avons été heureux, pauvre chère femme, et je t’aime de toutes sortes de façons. Tu as fait vis-à-vis de Bouilhet quelque chose qui m’a été au cœur. C’était bien bon (et bien habile ?). Ç’aura été son premier succès, à ce pauvre Bouilhet. Il se rappellera cette petite soirée toute sa vie. Ma muse intérieure t’en bénit et envoie à ton âme son plus tendre baiser. – Non, je ne t’oublierai pas, quoi qu’il advienne, et je reviendrai à ton affection à travers toutes les autres. – Tu seras un carrefour, un point d’intersection de plusieurs entre-croisements (je tombe dans le Sainte-Beuve ; sautons).
Et d’ailleurs, est-ce qu’on oublie quelque chose, est-ce que rien se passe, est-ce qu’on peut se détacher de quoi que ce soit ? Les natures les plus légères elles-mêmes, si elles pouvaient réfléchir un moment, seraient étonnées de tout ce qu’elles ont conservé de leur passé. – Il y a des constructions souterraines à tout. – Ce n’est qu’une question de surface et de profondeur. Sondez et vous trouverez. – Pourquoi a-t-on cette manie de nier, de conspuer son passé, de rougir d’hier et de vouloir toujours que la religion nouvelle efface les anciennes ? – Quant à moi, je jure devant toi que j’aime, que j’aime encore tout ce que j’ai aimé, et que, quand j’en aimerai une autre, je t’aimerai toujours. Le cœur dans ses affections, comme l’humanité dans ses idées, s’étend sans cesse en cercles plus élargis. – De même que je regardais, il y a quelques jours, mes petits livres d’enfant dont je me rappelais nettement toutes les images, quand je regarde mes années disparues, j’y retrouve tout. Je n’ai rien arraché, rien perdu. On m’a quitté, je n’ai rien délaissé. – Successivement j’ai eu des amitiés vivaces qui se sont dénouées les unes après les autres. – Ils ne [se] souviennent plus de moi, je me souviens toujours. C’est la complexion de mon esprit dont l’écorce est dure. J’ai les nerfs enthousiastes avec le cœur lent ; mais peu à peu la vibration descend et elle reste au fond.
—–
Avant-hier au soir, on m’a remis un petit paquet enveloppé dans de la toile cirée et qui avait été adressé chez mon frère. – C’était un carré de filet de coton pour servir de housse à un fauteuil. – J’ai cru reconnaître l’écriture d’Henriette Collier sur l’adresse ; mais pas de lettre, pas d’avis, rien, et aucune nouvelle.
Il paraît donc que les femmes s’occupent de moi. Je vais devenir fat. Mme Didier elle-même trouve que j’ai l’air distingué. Est-ce que je serais digne par hasard de figurer dans les brillantes sociétés où va Du Camp ?
—–
Caroline de Lichtfield est très pénible à lire. – J’ai vu ce que c’était et m’arrête avant la fin du 1er volume.
J’ai lu la moitié de celui du sieur d’Arpentigny. C’est curieux et fort spirituel en certaines parties. Veux-tu que je t’écrive pour nous amuser une lettre officielle sur son bouquin, où je ferai des remarques ? J’ai envie de m’en faire un ami, de ce pauvre père d’Arpentigny. Je ne sais pourquoi, mais je crois qu’il se divertit intérieurement sur notre compte et qu’il m’envie ma place. Par égard pour son âge tu devrais bien la lui céder un peu, quitte à la reprendre, quoique cette idée de fourrager après lui m’excite peu. – À propos d’excitations, Bouilhet l’est tout à fait (excité) par Mme Roger. Demain je verrai le fameux sonnet. Nous causerons aussi de l’article et de tout ce qu’il y a à faire. N’oublie [pas] de nous écrire distinctement les noms des deux particuliers de La Presse à qui il faut envoyer des Melaenis.
Quant à La Bretagne, je ne serais pas fâché que Gautier la lût maintenant. Mais si tu es tout entière à ta comédie, restes-y ; c’est plus important. Pioche ferme. Si je t’avais seulement sous mes yeux pendant quatre mois de suite, bien libre de toute autre chose, tu verrais comme je te ferais travailler et comme il faut peu de chose pour changer le médiocre en bon et le bon en excellent. En tous cas n’envoie La Bretagne à Gautier (et non Gauthier) que quand tu l’auras lue, et avertis-moi, je t’enverrai un petit mot à mettre dans le paquet. –
Adieu, je vais me coucher ; à demain.
Ô ! dieu des Songes, fais-moi rêver ma Dulcinée ! As-tu remarqué quelquefois le peu d’empire de la volonté sur les rêves ? comme il est libre, l’esprit, dans le sommeil, et où il va !