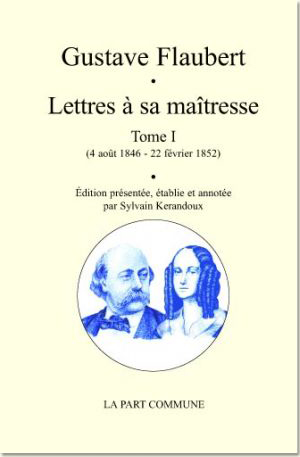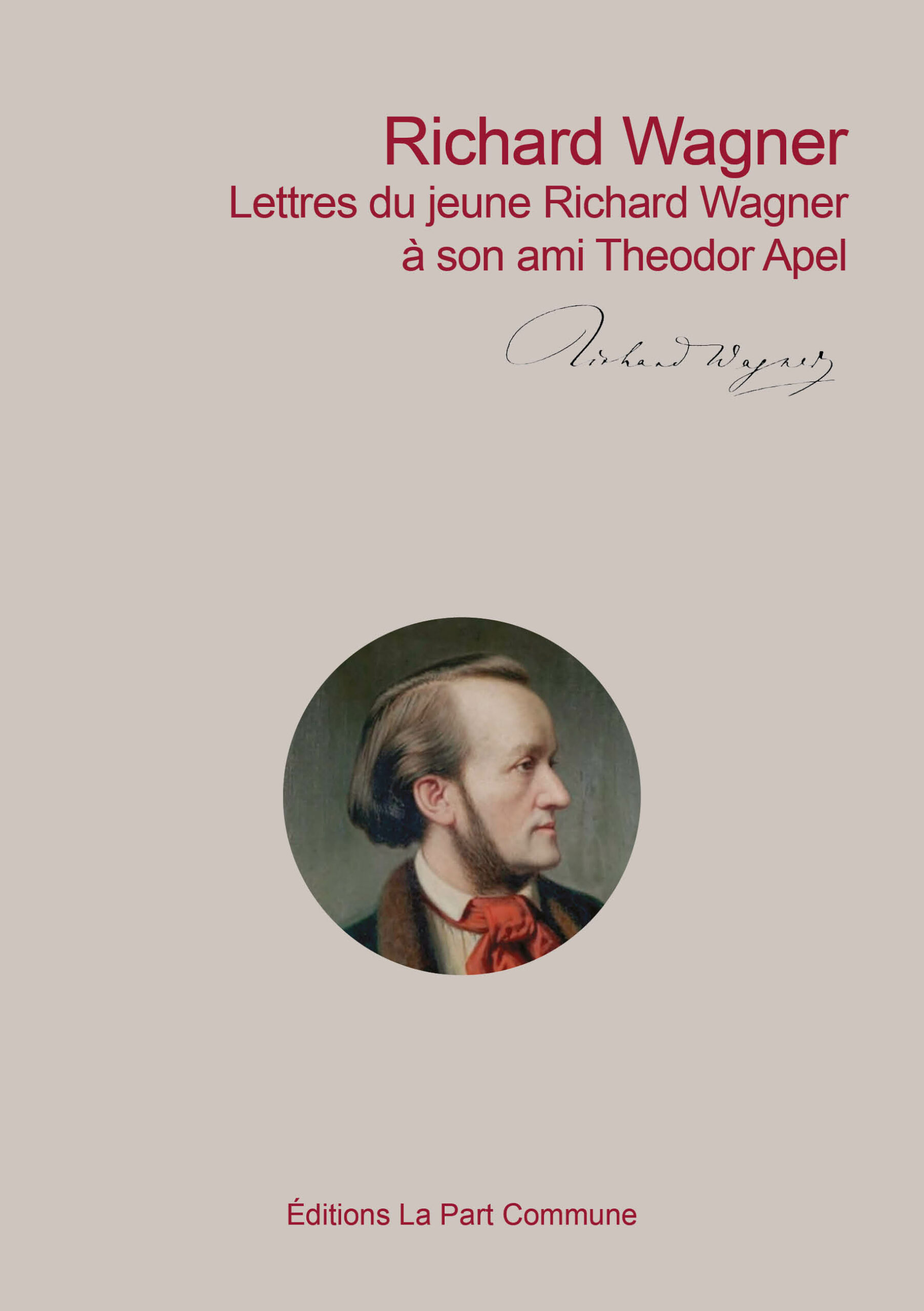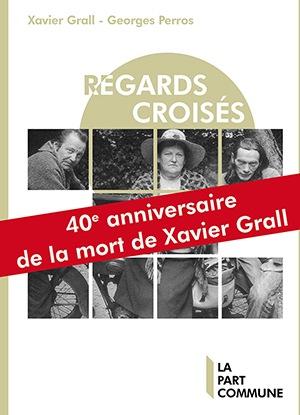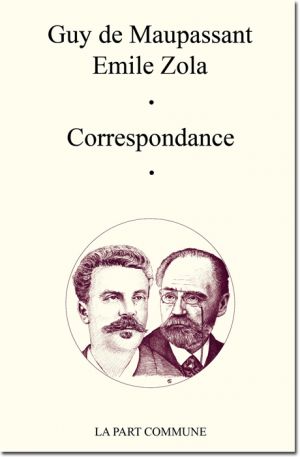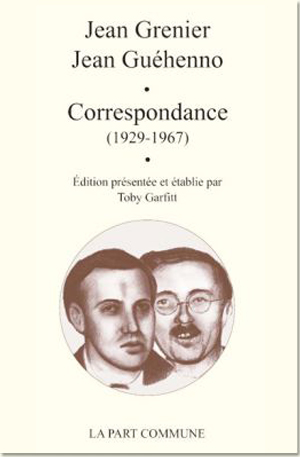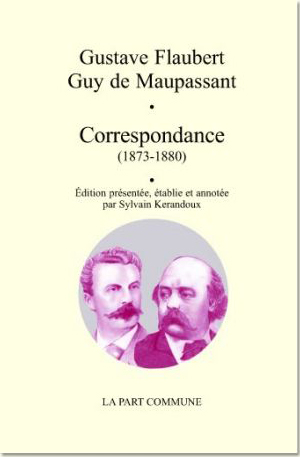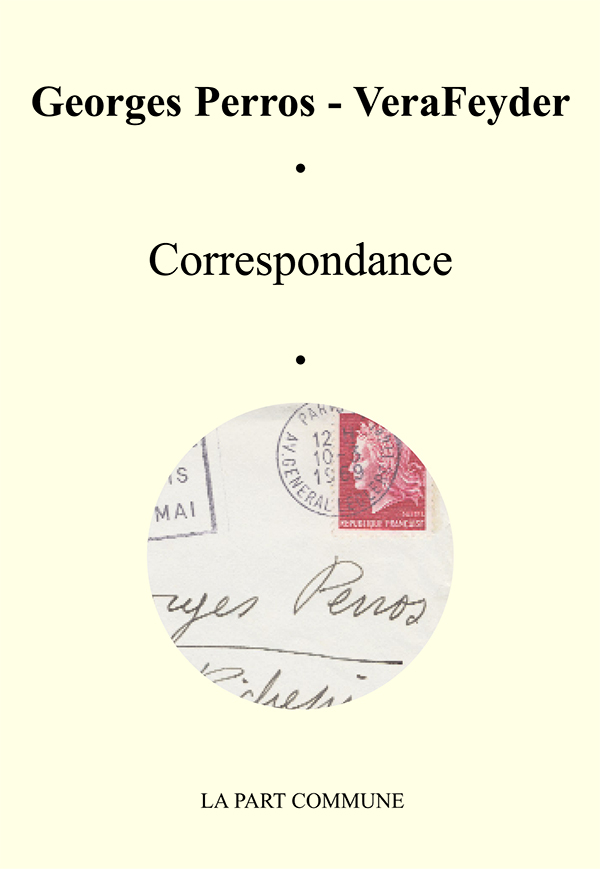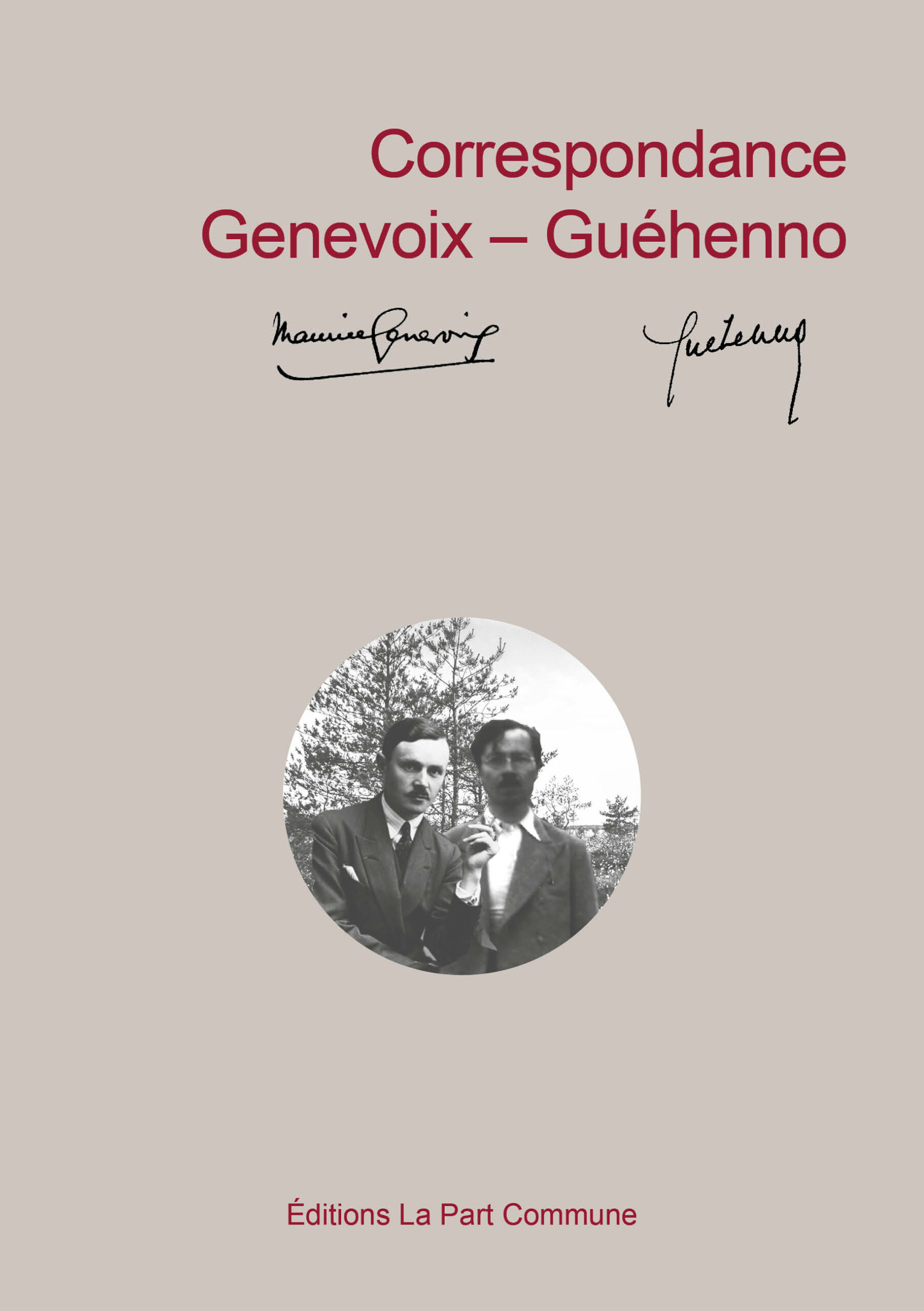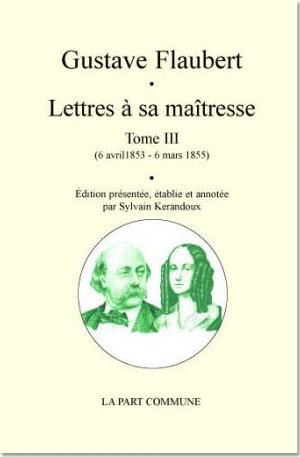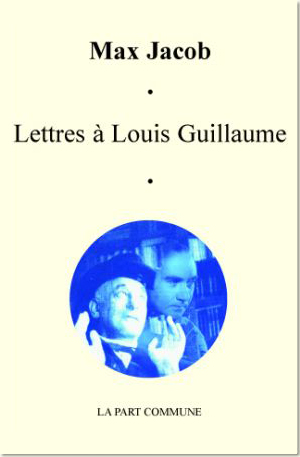1846
Lettre 1
Mardi soir, minuit [4 août 1846].
Il y a douze heures nous étions encore ensemble. Hier à cette heure-ci je te tenais dans mes bras… t’en souviens-tu ?… Comme c’est déjà loin ! La nuit maintenant est chaude et douce ; j’entends le grand tulipier, qui est sous ma fenêtre frémir au vent et, quand je lève la tête, je vois la lune se mirer dans la rivière. Tes petites pantoufles sont là pendant que je t’écris, je les ai sous les yeux, je les regarde. Je viens de ranger, tout seul et bien enfermé, tout ce que tu m’as donné. Tes deux lettres sont dans le sachet brodé, je vais les relire quand j’aurai cacheté la mienne. – Je n’ai pas voulu prendre pour t’écrire mon papier à lettres, il est bordé de noir, que rien de triste ne vienne de moi vers toi ! Je voudrais ne te causer que de la joie et t’entourer d’une félicité calme et continue pour te payer un peu tout ce que tu m’as donné à pleines mains dans la générosité de ton amour. J’ai peur d’être froid, sec, égoïste, et Dieu sait pourtant ce qui à cette heure se passe en moi. Quel souvenir ! et quel désir ! – Ah ! nos deux bonnes promenades en calèche, qu’elles étaient belles ! La seconde surtout avec ses éclairs ! Je me rappelle la couleur des arbres éclairés par les lanternes, et le balancement des ressorts ; nous étions seuls, heureux, je contemplais ta tête dans la nuit, je la voyais malgré les ténèbres, tes yeux t’éclairaient toute la figure. – Il me semble que j’écris mal, tu vas lire ça froidement, je ne dis rien de ce que je veux dire. C’est que mes phrases se heurtent comme des soupirs, pour les comprendre il faut combler ce qui sépare l’une de l’autre, tu le feras n’est-ce pas ? Rêveras-tu à chaque lettre, à chaque signe de l’écriture, comme moi en regardant tes petites pantoufles brunes je songe aux mouvements de ton pied quand il les emplissait et qu’elles en étaient chaudes. Le mouchoir est dedans, je vois ton sang. – Je voudrais qu’il en fût tout rouge.
Ma mère m’attendait au chemin de fer. Elle a pleuré en me voyant revenir. Toi tu as pleuré en me voyant partir. Notre misère est donc telle que nous ne pouvons nous déplacer d’un lieu sans qu’il en coûte des larmes des deux côtés ! C’est d’un grotesque bien sombre. – J’ai retrouvé ici les gazons verts, les arbres grands et l’eau coulant comme lorsque je suis parti. Mes livres sont ouverts à la même place, rien n’est changé. La nature extérieure nous fait honte, elle est d’une sérénité désolante pour notre orgueil. N’importe, ne songeons ni à l’avenir ni à nous ni à rien. Penser c’est le moyen de souffrir. Laissons-nous aller au vent de notre cœur tant qu’il enflera la voile. Qu’il nous pousse comme il lui plaira et quant aux écueils… ma foi tant pis, nous verrons.
Et ce bon X… qu’a-t-il dit de l’envoi ? Nous avons ri hier au soir. – C’était tendre pour nous, gai pour lui, bon pour nous trois. J’ai lu en venant presque un volume. J’ai été touché à différentes places. Je te causerai de ça plus au long. – Tu vois bien que je ne suis pas assez recueilli. La critique me manque tout à fait ce soir. J’ai voulu seulement t’envoyer encore un baiser avant de m’endormir, te dire que je t’aimais. À peine t’ai-je eu quittée et à mesure que je m’éloignais ma pensée revolait vers toi. Elle courait plus vite que la fumée de la locomotive qui fuyait derrière nous – (il y a du feu dans la comparaison) – pardon de la pointe. Allons, un baiser, vite, tu sais comment, de ceux que dit l’Arioste, et encore un, oh encore, encore et puis ensuite sous ton menton, à cette place que j’aime sur ta peau si douce, sur ta poitrine où je place mon cœur.
Adieu, adieu.
Tout ce que tu voudras de tendresses.
*
Lettre 2
[Croisset, jeudi 6 ou vendredi 7 août 1846]
Je suis brisé, étourdi, comme après une longue orgie, je m’ennuie à mourir. J’ai un vide inouï dans le cœur, moi si calme naguère, si fier de ma sérénité, et qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue, je ne puis ni lire ni penser ni écrire. Ton amour m’a rendu triste. Je vois que tu souffres, je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t’avoir connue, pour toi, pour moi ensuite et cependant ta pensée m’attire sans relâche. J’y trouve une douceur exquise. Ah ! qu’il eût mieux valu en rester à notre première promenade. Je me doutais de tout cela ! Quand le lendemain je ne suis pas venu chez Phidias, c’est que je me sentais déjà glisser sur la pente. J’ai voulu m’arrêter, qu’est-ce qui m’y a poussé ? Tant pis : tant mieux. – Je n’ai pas reçu du ciel une organisation facétieuse. Personne plus que moi n’a le sentiment de la misère de la vie. Je ne crois à rien, pas même à moi ce qui est rare. Je fais de l’art parce que ça m’amuse mais je n’ai aucune foi dans le beau, pas plus que dans le reste. Aussi l’endroit de ta lettre, pauvre âme, où tu me parles de patriotisme m’aurait bien fait rire si j’avais été dans une disposition plus gaie. Tu vas croire que je suis dur. Je voudrais l’être. Tous ceux qui m’abordent s’en trouveraient mieux et moi aussi dont le cœur a été mangé comme l’est à l’automne l’herbe des prés par tous les moutons qui ont passé dessus. Tu n’as pas voulu me croire quand je t’ai dit que j’étais vieux. Hélas ! oui. Car tout sentiment qui arrive dans mon âme s’y tourne en aigreur comme le vin que l’on met dans des vases qui ont trop servi. – Si tu savais toutes les forces internes qui m’ont épuisé, toutes les folies qui m’ont passé par la tête, tout ce que j’ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions tu verrais que je ne suis pas si jeune. C’est toi qui es enfant, c’est toi qui es fraîche et neuve, toi dont la candeur me fait rougir. Tu m’humilies par la grandeur de ton amour. Tu méritais mieux que moi. Que la foudre m’écrase, que toutes les malédictions possibles tombent sur moi si jamais je l’oublie ! Te mépriser ! m’écris-tu, parce que tu t’es donnée trop tôt à moi. As-tu pu le penser ? Jamais, jamais, quoi que tu fasses, quoi qu’il arrive. Je te suis dévoué pour la vie, à toi, à ta fille, à ceux que tu voudras. C’est là un serment, retiens-le, uses-en. Je le fais parce que je puis le tenir.
Oui je te désire et je pense à toi. Je t’aime plus que je ne t’aimais à Paris. Je ne puis plus rien faire, toujours je te revois dans l’atelier debout près de ton buste, les papillotes remuantes sur tes épaules blanches, ta robe bleue, ton bras, ton visage, que sais-je, tout. Tiens. Maintenant la force me circule dans le sang. Il me semble que tu es là, je suis en feu, mes nerfs vibrent… tu sais comment… tu sais quelle chaleur ont mes baisers.
Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions tu te demandes d’où vient ma réserve à ajouter « pour toujours ». Pourquoi ? C’est que je devine l’avenir, moi. C’est que sans cesse l’antithèse se dresse devant mes yeux. Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il deviendrait vieillard ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d’une femme nue me fait rêver à son squelette. C’est ce qui fait que les spectacles joyeux me rendent triste et que les spectacles tristes m’affectent peu. – Je pleure trop en dedans pour verser des larmes au dehors. Une lecture m’émeut plus qu’un malheur réel. Quand j’avais une famille j’ai souvent souhaité n’en avoir pas, pour être plus libre, pour aller vivre en Chine ou chez les sauvages. Maintenant que je n’en ai plus je la regrette et je m’accroche aux murs où son ombre reste encore. – D’autres seraient fiers de l’amour que tu me prodigues, leur vanité y boirait à l’aise, et leur égoïsme de mâle en serait flatté jusqu’en ses replis les plus intimes. Mais cela me fait défaillir le cœur de tristesse, quand les moments bouillants sont passés, car je me dis : « Elle m’aime, et moi qui l’aime aussi je ne l’aime pas assez. Si elle ne m’avait pas connu je lui aurais épargné toutes les larmes qu’elle verse ». Pardonne-moi ceci, pardonne-le-moi au nom de tout ce que tu m’as fait goûter d’ivresse. Mais j’ai le pressentiment d’un malheur immense pour toi. J’ai peur que mes lettres ne soient découvertes, qu’on apprenne tout. – Je suis malade de toi. Tu crois que tu m’aimeras toujours, enfant. Toujours, quelle présomption dans une bouche humaine ! Tu as aimé déjà, n’est-ce pas, comme moi ? Souviens-toi qu’autrefois aussi tu as dit : toujours. Mais je te rudoie, je te chagrine, tu sais que j’ai les caresses féroces… N’importe, j’aime mieux inquiéter ton bonheur maintenant que de l’exagérer froidement, comme ils font tous, pour que sa perte ensuite te fasse souffrir davantage… Qui sait ? Tu me remercieras peut-être plus tard d’avoir eu le courage de n’être pas plus tendre. Ah ! si j’avais vécu à Paris ! Si tous les jours de ma vie avaient pu se passer près de toi, oui, je me laisserais aller à ce courant sans crier au secours ! J’aurais trouvé en toi, pour mon cœur, mon corps et ma tête, un assouvissement quotidien qui ne m’eût jamais lassé. Mais séparés ; destinés à nous voir rarement, c’est affreux. Quelle perspective ! Et que faire ? pourtant… Je ne conçois pas comment j’ai fait pour te quitter. C’est bien moi, cela ! C’est bien dans ma pitoyable nature. Tu ne m’aimerais pas, j’en mourrais, tu m’aimes et je suis à t’écrire de t’arrêter. Ma propre bêtise me dégoûte moi-même. C’est que de tous les côtés que je me retourne je ne vois que malheur. J’aurais voulu passer dans ta vie comme un frais ruisseau qui en eût rafraîchi les bords altérés et non comme un torrent qui la ravage. Mon souvenir aurait fait tressaillir ta chair et sourire ton cœur. Ne me maudis jamais ! Va, je t’aurai bien aimée avant que je ne t’aime plus. Moi je te bénirai toujours. Ton image me restera toute imbibée de poésie et de tendresse comme l’était hier la nuit dans la vapeur laiteuse de son brouillard argenté. – Ce mois-ci je t’irai voir. Je te resterai un grand jour entier. Avant quinze jours, douze même, je serai à toi. Que Phidias m’écrive, et j’accours, c’est convenu. Est-il remis de sa colère, ce bon Phidias ? A-t-il compris le sens du cadeau ? Tâche de lui bien faire entendre que c’était pour le faire rire et rêver et lui rendre un peu de la satisfaction qu’il nous avait causée.
Tu veux que je t’envoie quelque chose de moi. – Non, tu trouverais tout trop bien. Ne m’as-tu pas assez donné sans y joindre tes éloges littéraires ? Tu veux donc achever de me rendre fat. Et puis je n’ai rien de lisible ; tu ne t’y reconnaîtrais pas au milieu des ratures et des renvois, n’ayant rien fait recopier. N’as-tu pas peur de te gâter le style en me fréquentant ? Tu voudrais que je publiasse quelque chose tout de suite, tu m’exciterais, tu finirais par faire que je me prendrais au sérieux (ce dont le ciel me garde !). Autrefois la plume courait sur mon papier avec vitesse. Elle y court aussi maintenant mais elle le déchire. Je ne peux pas faire une phrase, je change de plume à toute minute, parce que je n’exprime rien de ce que je veux dire. – Tu viendras à Rouen avec Phidias, tu feras semblant de l’y rencontrer et tu me feras une visite ici. Cela te satisfera mieux que toutes les descriptions possibles. Alors tu penseras à mon tapis et à la grande peau d’ours blanc sur laquelle je me couche dans le jour comme moi je pense à ta lampe d’albâtre, quand je regardais sa lumière mourante onduler sur le plafond. Avais-tu compris, ce soir-là, que je m’étais donné ce terme, car je n’osais pas, je suis timide va, malgré mon cynisme, à cause de lui peut-être. Je m’étais dit : j’attendrai jusqu’à ce que la bougie soit éteinte. Oh ! quel oubli de tout, quelle exclusion du reste du monde… comme elle était douce la peau de ton corps nu… et quelle joie hypocrite je savourais, dans mon dépit, pendant que les autres étaient là et qu’ils ne s’en allaient pas ! Je me souviendrai toujours de l’air de ta tête quand tu étais à mes genoux, par terre, et de ton sourire ivre quand tu m’as ouvert la porte et que nous nous sommes quittés. Je suis descendu dans les ténèbres, sur la pointe du pied, comme un voleur. N’en étais-je pas un ? Et tous sont-ils aussi heureux quand ils fuient chargés de leur butin ? Je te dois une explication franche de moi-même pour répondre à une page de ta lettre qui me fait voir les illusions que tu as sur mon compte. Il serait lâche à moi (et la lâcheté est un vice qui me dégoûte sous quelque face qu’il se montre) de les faire durer plus longtemps.
Le fond de ma nature est, quoi qu’on dise, le saltimbanque. J’ai eu dans mon enfance et ma jeunesse un amour effréné des planches. J’aurais été peut-être un grand acteur si le ciel m’a[vait] fait naître plus pauvre. Encore maintenant ce que j’aime par-dessus tout c’est la forme, pourvu qu’elle soit belle, et rien au-delà. Les femmes qui ont le cœur trop ardent et l’esprit trop exclusif ne comprennent pas cette religion de la beauté abstraction faite du sentiment. Il leur faut toujours une cause, un but. Moi j’admire autant le clinquant que l’or. La poésie du clinquant est même supérieure en ce qu’elle est triste. Il n’y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, rien. J’aurais mieux aimé être Talma que Mirabeau parce qu’il a vécu dans une sphère de beauté plus pure. – Les oiseaux en cage me font tout autant de pitié que les peuples en esclav[ag]e. De toute la politique il n’y a qu’une chose que je comprenne, c’est l’émeute. Fataliste comme un Turc, je crois que tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l’humanité ou rien, c’est absolument la même chose. Quant à ce progrès j’ai l’entendement obtus pour les idées peu claires. Tout ce qui appartient à ce langage m’assomme démesurément. Je déteste assez la tyrannie moderne parce qu’elle me paraît bête, faible et timide d’elle-même, mais j’ai un culte profond pour la tyrannie antique que je regarde comme la plus belle manifestation de l’homme qui ait été. Je suis avant tout l’homme de la fantaisie, du caprice, du décousu. J’ai songé longtemps et très sérieusement (ne va pas rire, c’est le souvenir de mes plus belles heures) à aller me faire renégat à Smyrne. À quelque jour j’irai vivre loin d’ici et l’on n’entendra plus parler de moi. Quant à ce qui d’ordinaire touche les hommes de plus près, et ce qui pour moi est secondaire, en fait d’amour physique, je l’ai toujours séparé de l’autre. Je t’ai vu railler cela l’autre jour à propos de J.J.. C’était mon histoire. Tu es bien la seule femme que j’aie aimée et que j’ai[e] eue. Jusqu’à alors j’allais calmer sur d’autres les désirs donnés par d’autres. Tu m’as fait mentir à mon système, à mon cœur, à ma nature peut-être qui, incomplète d’elle-même, cherche toujours l’incomplet.
J’en ai aimé une depuis 14 ans jusqu’à 20 sans le lui dire, sans lui [sic] toucher, et j’ai été près de trois ans ensuite sans sentir mon sexe. J’ai cru un moment que je mourrais ainsi, j’en remerciais le ciel. – Je voudrais n’avoir ni corps ni cœur, ou plutôt je voudrais être crevé car la mine que je fais ici-bas est d’un ridicule exagéré. C’est là ce qui me rend défiant et timide de moi-même. Tu es la seule à qui j’aie osé vouloir plaire, et peut-être la seule à qui j’aie plu. Merci, merci. Mais me comprendras-tu jusqu’au bout, supporteras-tu le poids de mon ennui, mes manies, mes caprices, mes abattements et mes retours emportés ? Tu me dis par exemple de t’écrire tous les jours, et si je ne le fais, tu vas m’accuser. Eh bien, l’idée que tu veux une lettre chaque matin m’empêchera de la faire. Laisse-moi t’aimer à ma guise, à la mode de mon être, avec ce que tu appelles mon originalité. Ne me force à rien, je ferai tout. Comprends-moi et ne m’accuse pas. Si je te jugeais légère et niaise comme les autres femmes je te paierais de mots, de promesses, de serments. Qu’est-ce que cela me coûterait ? Mais j’aime mieux rester en dessous qu’au-dessus de la vérité de mon cœur.
Les Numides, dit Hérodote, ont une coutume étrange. On leur brûle tout petits la peau du crâne avec des charbons pour qu’ils soient ensuite moins sensibles à l’action du soleil qui est dévorante dans leur pays. Aussi sont-ils de tous les peuples de la terre ceux qui se portent le mieux. Songe que j’ai été élevé à la Numide. N’avait-on pas beau jeu à leur dire : Vous ne sentez rien, le soleil même ne vous chauffe pas. – Oh, n’aie pas peur, pour avoir du caille au cœur il n’est pas moins bon. Eh bien non, en me sondant, je ne me trouve pas meilleur que mon voisin. J’ai seulement assez de perspicacité et quelque délicatesse dans les manières.
Voilà le soir qui vient. J’ai passé mon après-midi à t’écrire. À 18 ans, à mon retour du Midi, j’ai écrit pendant six mois des lettres pareilles à une femme que je n’aimais pas. – C’était pour me forcer à l’aimer, pour faire du style sérieux. Et ici c’est tout le contraire, le parallélisme est accompli. – Encore un dernier mot. J’ai à Paris un homme à mes ordres, dévoué jusqu’à la mort, actif, brave, intelligent, une grande et héroïque nature aux ordres volontés de la mienne. – En cas de besoin compte sur lui comme sur moi. J’attends demain tes vers, dans quelques jours tes deux volumes. Adieu, pense à moi, oui embrasse ton bras. Tous les soirs ce sont tes œuvres que je lis. J’y recherche des traces de toi-même. J’en trouve quelquefois. – Adieu, adieu, je mets ma tête sur tes seins et je te regarde de bas en haut comme une madone.
11 heures du soir.
Adieu, je ferme ma lettre. C’est l’heure où, seul et pendant que tout dort, je tire le tiroir où sont mes trésors. Je contemple tes pantoufles, le mouchoir, tes cheveux, le portrait, je relis tes lettres, j’en respire l’odeur musquée. Si tu savais ce que je sens maintenant !… dans la nuit mon cœur se dilate et une rosée d’amour le pénètre. Mille baisers, mille, partout, partout.