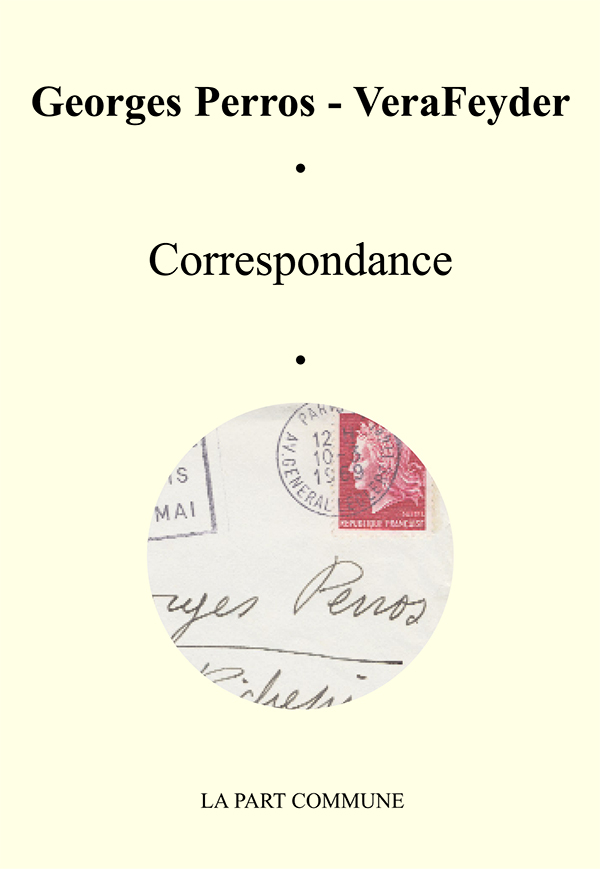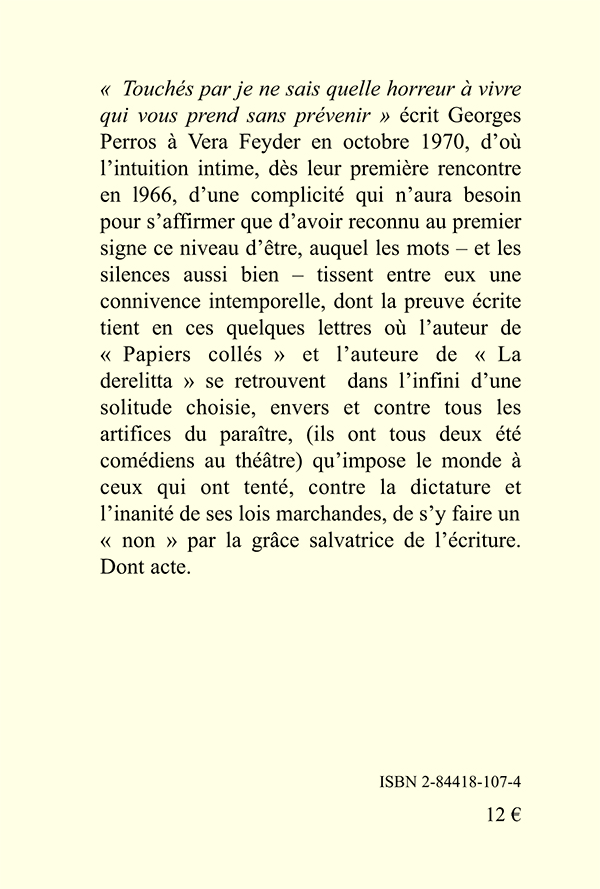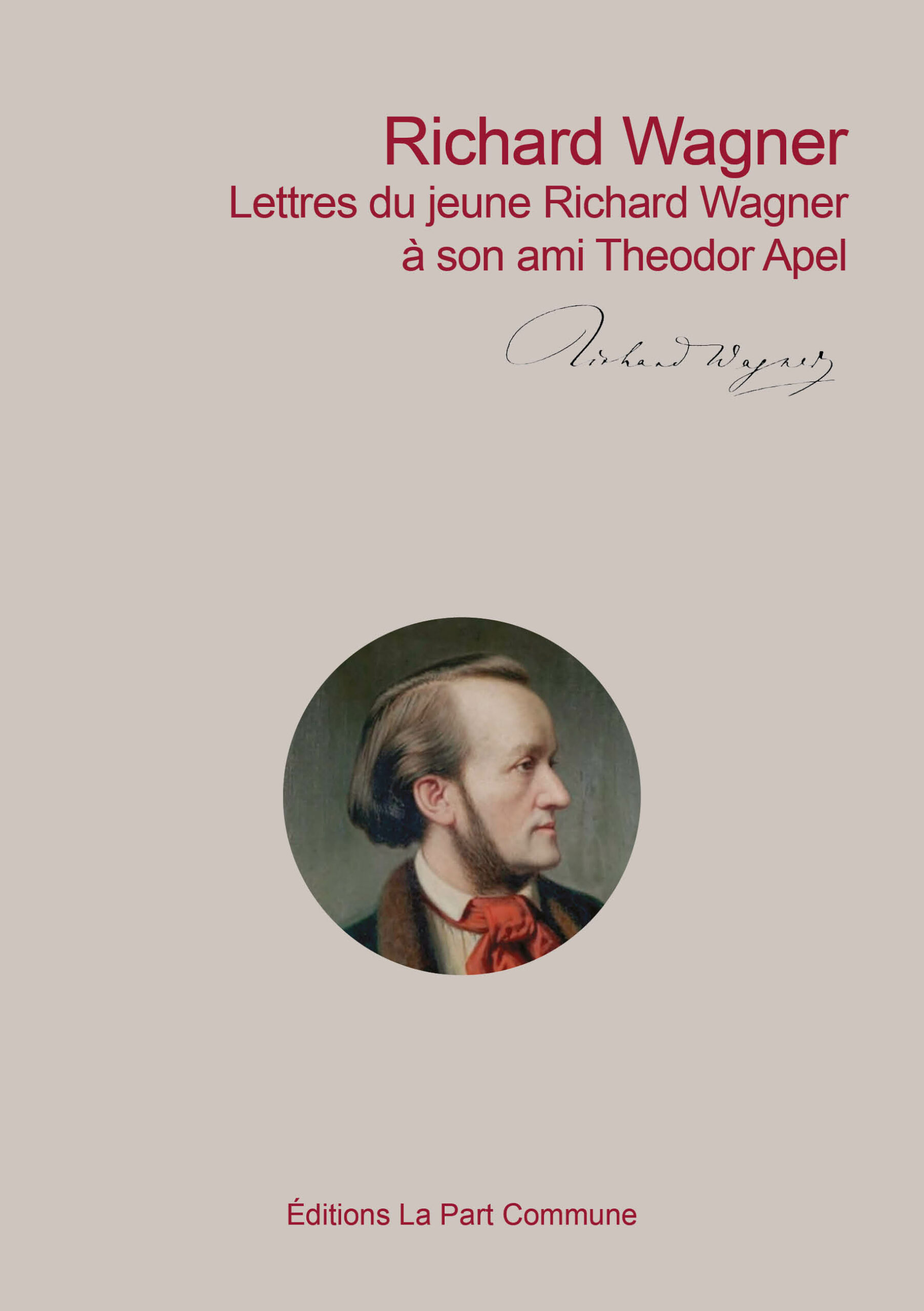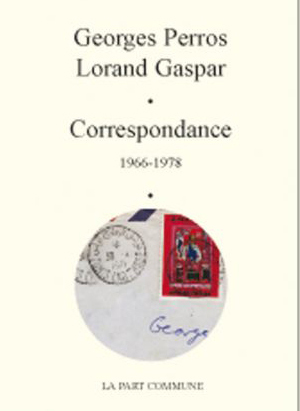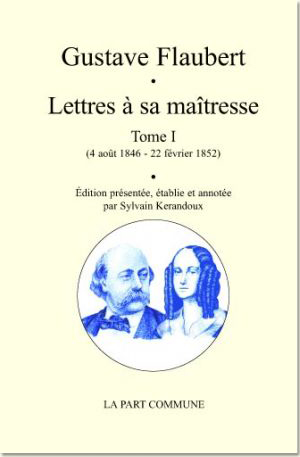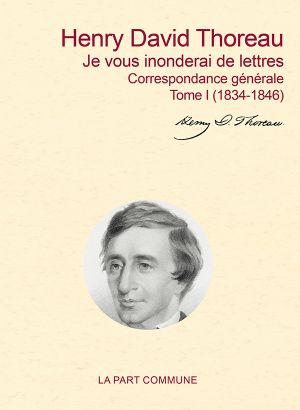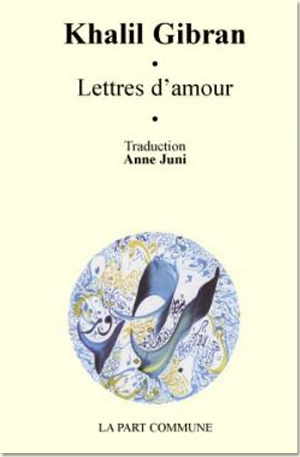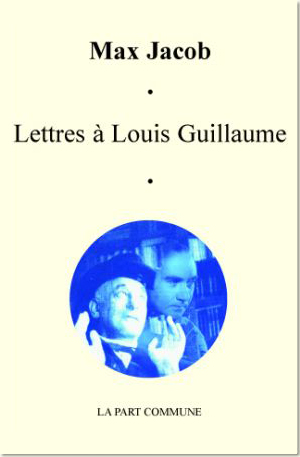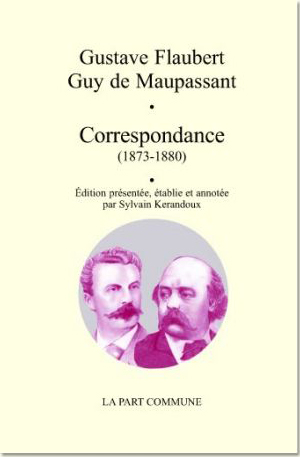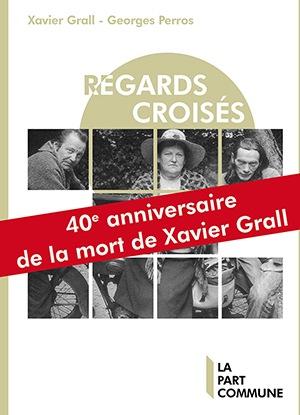Chère Vera F.
Plaisir à recevoir votre mot. Mon Dieu, toujours là, un peu dans le coma dans un pays – la France – que j’éprouve le plus grand mal à sentir. J’ai l’impression que nous sommes tous dans l’antichambre, trop jeunes, trop vieux, coincés. Une fois de plus, la vie va foutre le camp sans avoir jeté son jus.
Rien de pessimiste là-dessous. Mais, je ne parle pas de vous, avec qui ? – mais je vous entends parfois à la radio, et je regrette de vous connaître si peu. Il faudra réparer ce manque. J’irai à Paris avant Pâques, et je vous téléphonerai, à tout hasard souhaité comblé… On pourrait déjeuner ensemble.
Je vous salue bien.
Georges.
Merci. Quatre-vingt douze printemps, c’est un bel âge. Vous m’aviez paru légèrement plus jeune. Mais a t’on un âge ? C’est un beau texte, dur, rugueux, déchiré. J’attends vos poèmes. N’y manquez pas.
Aujourd’hui, les bateaux sont tous du côté du soleil, nous n’aurons guère de pluie, ce qui me ferait du bien. J’ai beau me baigner, ce qui devrait prendre l’eau reste sec. Sec comme la mort. Ou l’âme.
Je vous trouve très courageuse d’avoir lu mes notes. Elles ne sont pas faites pour être lues. Je me demande parfois ce qu’elles
veulent dire. Quand je le saurai, je pourrai les détruire, et écrire, peut-être, quelques pages possibles. On a tout le temps.
J’irai, probablement, faire un rapide tour à Paris, courant octobre. Si j’ose, je vous téléphonerai. Cet engin – le téléphone – m’effraie un peu. Mais j’aurai plaisir à vous revoir. Alors, à un de ces quatre ! Je vous salue bien.
Georges. P
Paris, il pleut
Voici les deux T.M. Pour ce qui est du recueil – premiers poèmes – je ne renie pas, non… Je n’ose pas, un peu comme vous pour le téléphone. Cinq ans de cela : j’entrais en éther comme on se noie : premier suicide par les mots, c’était naïf et c’est de cette naïveté-là que j’ai un peu honte : aujourd’hui que je me suis fait une belle armure je n’aime plus tellement me sentir à découvert – enfin plus de cette façon-là.
Non, je ne vous crois pas sec – Dieu merci – enfin pour l’essentiel : le regard, le cœur, c’est la même ouverture ; pour le reste, nous avons tous des bois morts qui s’entassent : encore trop verts pour l’eau comme pour le feu, ça ne compte pas.
Ce qu’on écrit n’a de sens que celui que nous suivons : la difficulté est d’épouser exactement ce qu’on est, d’accepter ses points de chute ; il me semble que vous y parvenez assez bien, peu importe comment.
Après tout, l’âme n’existe jamais qu’entre la vie et la mort : elle peut bien revêtir toutes les apparences (j’entre dans mon 93e hiver, ne l’oubliez pas !) elle seule, si quelque chose doit parler en nous, a son mot à dire : le reste est périssable. Tant pis si le corps et la raison ne sont pas d’accord.
Maintenant que nous sommes en sept. je ne trouve plus le n° d’Août de la N.R.F. ; il ne me faudra que le courage de le rechercher, pas celui de le lire !
écrivez-moi encore car – je ne l’avoue jamais – mais je suis comme ces grands vieillards auxquels l’air du large redonne un peu vie.