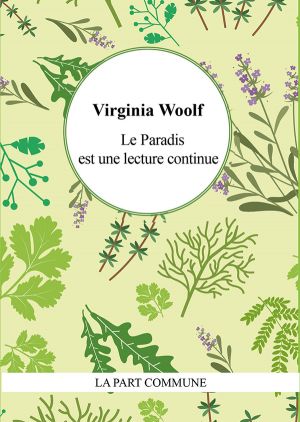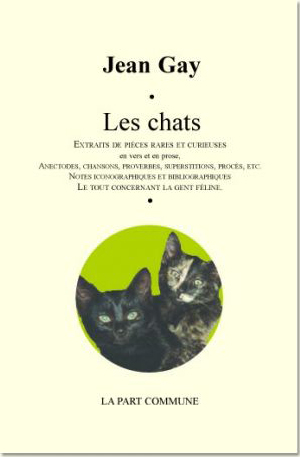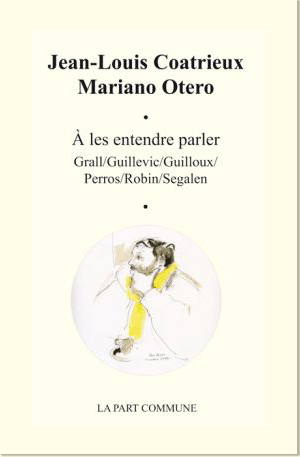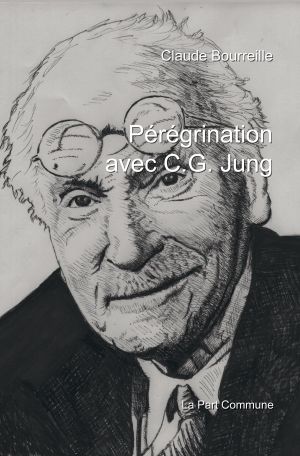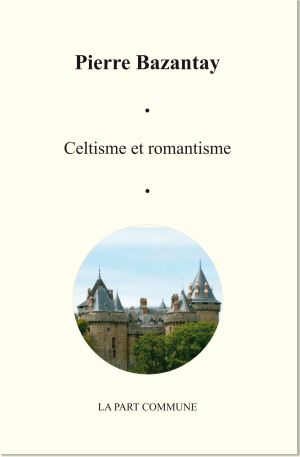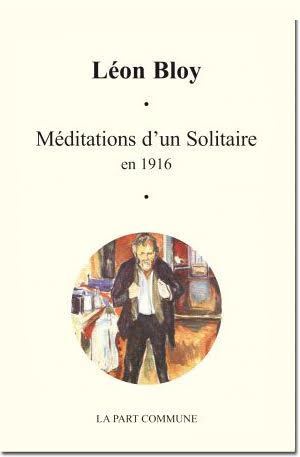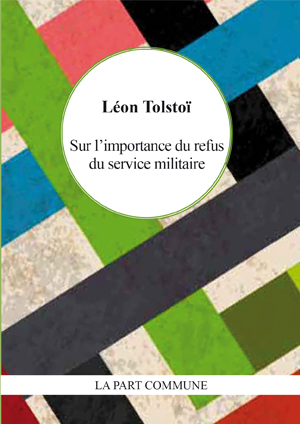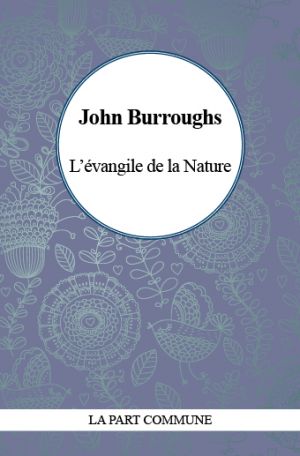Il y a cent ans aujourd’hui, le 12 juillet 1817, naissait Henry David Thoreau, fils d’un fabricant de crayons de Concord, dans le Massachusetts. Il a eu de la chance avec ses biographes, qui ont été attirés vers lui autant par sa renommée que par sympathie pour ses opinions, mais ils n’ont pas été en mesure de nous en dire beaucoup plus sur lui que ce que nous trouvions déjà dans ses propres livres. Il n’a pas eu de vie mouvementée ; il possédait, selon ses propres termes, « un véritable génie pour rester chez lui ». Sa mère était dynamique et volubile, et aimait tellement les balades en solitaire qu’il s’en fallut de peu que l’un de ses enfants ne vînt au monde en plein champ. Le père, quant à lui, était un « petit homme paisible et besogneux », ayant la faculté de fabriquer les meilleurs crayons à mine de plomb d’Amérique, grâce à un mélange secret de plombagine pulvérisée avec de la terre savonneuse et de l’eau, qu’il roulait dans des feuillets, coupait en bandes et faisait brûler. Toujours est-il qu’il put se permettre, en se serrant la ceinture et en demandant un peu d’aide, d’envoyer son fils à Harvard, bien que Thoreau lui-même n’attachât guère d’importance à cette opportunité onéreuse. C’est néanmoins à Harvard qu’il devient visible à nos yeux pour la première fois. Un camarade de classe vit beaucoup de choses chez le jeune garçon que nous devions reconnaître par la suite chez l’adulte, aussi, au lieu d’un portrait, nous citerons ce qui était visible aux alentours de l’année 1837 pour le regard pénétrant du Révérend John Weiss :
Il était froid et impassible. Sa poignée de main était moite et indifférente, comme s’il ramassait quelque chose en voyant votre main tendue. Ses yeux gris-bleu saillants semblaient le précéder quand il se rendait à la salle de cours de son pas indien. Il ne s’intéressait pas aux gens ; ses camarades de classe paraissaient très lointains. Ce côté rêveur planait toujours autour de lui, mais de façon moins lâche que les curieux habits fournis par les soins pieux des siens. Son expression n’avait pas encore été réveillée par la pensée ; il était calme, mais assez ennuyeux et plutôt besogneux. Les lèvres n’étaient pas encore fermes, même si se lisait presque une trace de suffisance satisfaite aux commissures. Il est évident à présent qu’il s’apprêtait à adopter sa future vision des choses avec beaucoup d’aplomb et la conscience de leur importance. Le nez était proéminent, mais sa courbe tombait mollement au-dessus de la lèvre supérieure, et nous nous souvenons qu’il ressemblait énormément à certaines sculptures de visages égyptiens, aux traits grossiers, mais méditatifs, immobiles, fixés dans un égoïsme mystique. Ses yeux cherchaient parfois du regard, comme s’il était tombé sur quelque chose ou qu’il s’était attendu à trouver quelque chose. En fait, ses yeux quittaient rarement le sol, même quand il était en pleine conversation avec vous.
Il continue en parlant de la « réserve et de l’inadaptation » de la vie de Thoreau à l’université. De toute évidence, le jeune homme ainsi décrit, dont les plaisirs physiques revenaient à marcher et camper, qui ne fumait rien d’autre que des « tiges de lys sèches », qui vénérait autant les vestiges indiens que les classiques grecs, qui dès sa prime jeunesse avait pris l’habitude de « tenir les comptes » avec son propre esprit dans un journal où ses pensées, ses sensations, ses études et ses expériences étaient passées quotidiennement en revue par ce visage égyptien et ce regard scrutateur – de toute évidence, ce jeune homme était destiné à décevoir à la fois ses parents, ses enseignants et tous ceux qui souhaitaient qu’il se fasse une place dans le monde et devienne quelqu’un d’important. Sa première tentative pour gagner sa vie de façon ordinaire, en devenant maître d’école, tourna court quand il fut confronté à la nécessité de fouetter ses élèves. À la place, il proposait de parler morale avec eux. Quand le comité scolaire fit savoir que l’école souffrirait de sa « clémence excessive », Thoreau battit solennellement six élèves avant de démissionner, en arguant que la tenue d’une école « était incompatible avec sa façon de procéder ». La façon de procéder que le jeune homme sans le sou entendait suivre consistait sans doute en des rendez-vous avec certains pins, certains étangs, certains animaux sauvages et certaines pointes de flèches indiennes dans les alentours, qui s’étaient déjà imposés à lui.
Mais pendant un certain temps, il devait vivre dans le monde des hommes, du moins dans cette partie du monde des plus remarquables dont Emerson était le centre, et qui professait les doctrines transcendantalistes. Thoreau s’installa dans la maison d’Emerson et très vite, à ce que disaient ses amis, c’est à peine si on le distinguait du prophète lui-même. Si on les écoutait parler tous les deux les yeux fermés, on n’aurait été bien incapable de dire quand Emerson s’arrêtait de parler et quand Thoreau commençait, « … dans ses manières, dans le timbre de sa voix, dans sa façon de s’exprimer, jusque dans ses hésitations et ses silences quand il parlait, il était devenu l’alter ego de Mr. Emerson ». Il est possible que cela ait été le cas. Les natures les plus fortes, quand elles sont influencées, se soumettent avec le moins de réserve ; c’est peut-être un signe de leur force. Mais les lecteurs de ses livres nieront certainement que Thoreau ait perdu un de peu de sa propre force dans ce processus, ou qu’il ait adopté de façon permanente des couleurs qui ne lui étaient pas naturelles.
Le mouvement transcendantaliste, comme la plupart des mouvements vigoureux, représentait l’effort d’une ou deux personnes remarquables pour se défaire des vieux habits qui leur étaient devenus inconfortables et pour s’adapter au plus près à ce qui leur paraissait être désormais les réalités. Le désir de réajustement avait, comme le rapporte Lowell et comme en attestent les mémoires de Margaret Fuller, ses symptômes ridicules et ses disciples grotesques. Mais parmi tous les hommes et femmes qui vivaient à une époque où la pensée était refaçonnée en commun, nous avons le sentiment que Thoreau était celui qui avait le moins besoin de s’adapter et qui, par nature, était le plus en harmonie avec le nouvel esprit. De naissance, il faisait partie de ces gens, comme le dit Emerson, qui ont « silencieusement donné leurs nombreuses adhésions à un nouvel espoir, et qui dans toutes les compagnies manifestent une plus grande confiance dans la nature et les ressources de l’homme que ne l’accorderont volontiers les lois de l’opinion populaire ». Il y avait deux modes de vie qui, aux yeux des chefs de file du mouvement, semblaient permettre d’atteindre ces nouveaux espoirs : l’un était la communauté coopérative, telle que Brook Farm, l’autre était la solitude dans la nature. Quand le moment fut venu de faire son choix, Thoreau opta catégoriquement pour le second. « Pour ce qui est des communautés, écrit-il dans son journal, je crois que je préférerais prendre mes quartiers de célibataire en enfer plutôt que d’embarquer pour le paradis ». Quelle qu’ait pu être la théorie, il y avait dans sa nature profonde « un singulier désir pour toute la nature sauvage » qui devait le mener à l’expérience décrite dans Walden, qu’elle parût bonne ou non aux autres. En vérité, il devait davantage mettre en pratique les doctrines des Transcendantalistes qu’aucun d’entre eux, et prouver ce que sont les ressources de l’homme en leur accordant toute sa confiance. Ainsi, à l’âge de vingt-sept ans, il choisit un coin de terre dans une forêt au bord des eaux vertes, claires et profondes de l’étang de Walden, construisit une cabane de ses propres mains, empruntant à contrecœur une hâche pour une partie de son ouvrage, et s’installa, comme il l’affirme, pour « affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu’elle avait à enseigner, et non pas découvrir à l’heure de ma mort que je n’avais pas vécu ».
Et à présent, nous avons la possibilité de parvenir à connaître Thoreau comme peu de personnes sont, y compris de leurs amis. Force est de dire que peu de gens s’intéressent à eux-mêmes autant que Thoreau s’intéressa à lui-même, car si nous sommes doués d’un intense égoïsme, nous faisons de notre mieux pour l’étouffer afin de vivre en bons termes avec nos voisins. Nous ne sommes pas assez sûrs de nous-mêmes pour briser complètement l’ordre établi. Telle fut l’aventure de Thoreau ; ses livres sont le récit de cette expérience et de ses résultats. Il a fait tout ce qu’il a pu pour augmenter sa compréhension de lui-même, pour encourager tout ce qui était particulier en lui, pour se soustraire au contact de toute force susceptible d’interférer avec ce don extrêmement précieux de la personnalité. C’était son devoir sacré, non pas envers lui seul mais envers le monde, et un homme n’est guère égoïste s’il est égoïste à une si grande échelle. En lisant Walden, récit de ses deux années passées dans les bois, nous avons le sentiment de voir la vie à travers une loupe très puissante. Marcher, manger, débiter des bûches, lire un peu, observer l’oiseau sur la branche, se préparer son repas : toutes ces occupations, quand elles sont raclées, nettoyées et ressenties à neuf, s’avèrent merveilleusement vastes et brillantes. Les choses ordinaires sont si étranges, les sensations habituelles si étonnantes que les confondre ou les perdre en vivant avec le troupeau et en adoptant les habitudes qui conviennent au plus grand nombre est un péché – un acte sacrilège. Qu’est-ce que la civilisation peut donner, quelles améliorations peut apporter le luxe à ces simples faits ? « Simplicité, simplicité, simplicité ! », tel est son cri. « Au lieu de trois repas par jour, n’en prenez qu’un le cas échéant ; au lieu de cent plats, cinq ; et réduisez tout le reste à l’avenant ».