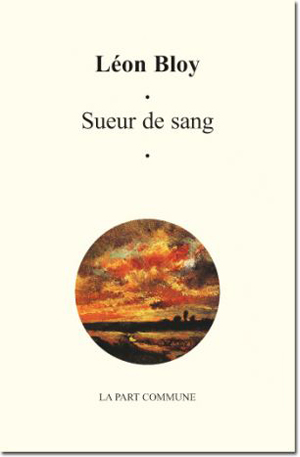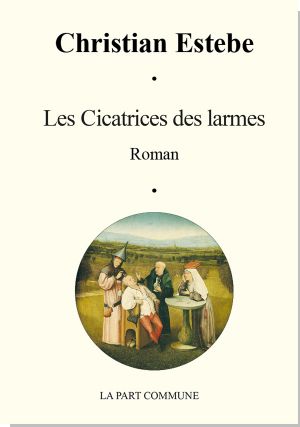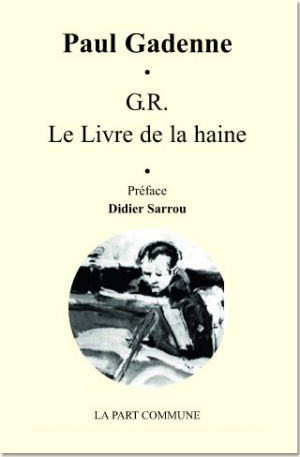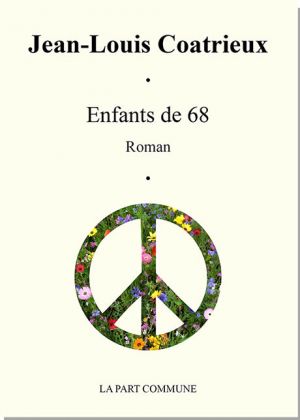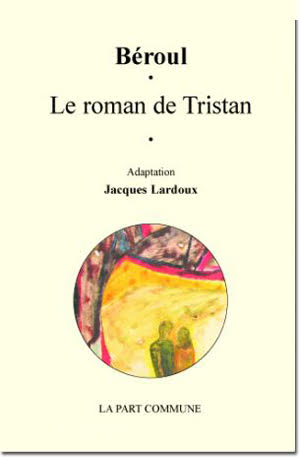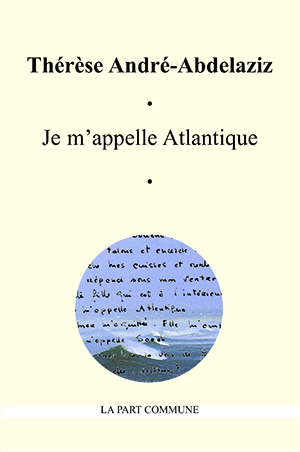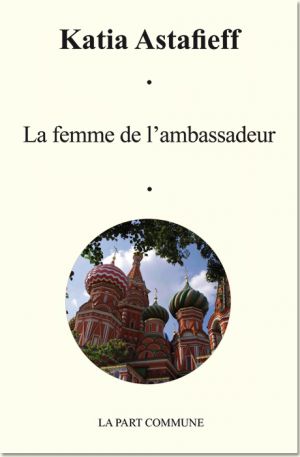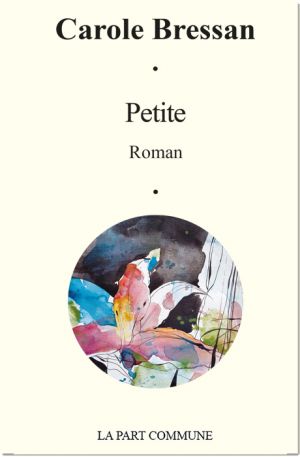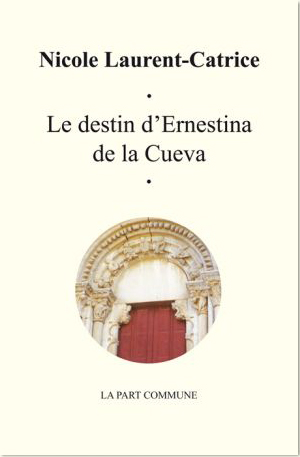I
L’abyssinien
Au Prince Alexandre Ourousof.
Ceci n’est pas même une anecdote. C’est à peine un souvenir, une sorte d’impression qui fut profonde, mais que vingt années environ d’une vie très chienne ont presque effacée.
J’appartenais en 1870 à un corps franc commandé par un agronome dévotieux, promu général en l’absence des Marceau ou des Bonaparte et que la circonspection de son héroïsme rendit un instant fameux.
Nous éclairions, paraît-il, l’armée de la Loire, les autres armées s’éclairant comme elles pouvaient, et nous fûmes, j’ose le dire, de terribles marcheurs et de formidables lapins devant Dieu.
Au fond, pourtant, la matière est peu risible, et je n’ose promettre une hilarité sans mesure aux gens folâtres qui me feront l’honneur de compter sur mon enjouement. Les choses plus ou moins historiques, militaires ou autres, dont je fus témoin cette année-là, m’apparurent quelquefois atroces, et mon genre d’esprit n’était pas précisément ce qu’il fallait pour en édulcorer l’impression.
Barbey d’Aurevilly, qui ne se cachait pas d’être un chauvin de ma sorte, m’avoua souvent que ce lui était une souffrance à peu près intolérable d’entendre parler de ce temps affreux. à plus forte raison, il lui eût été impossible d’écrire quoi que ce fût sur un tel sujet. Manière d’être qui sépara beaucoup cet artiste fier de certains alligators de l’écritoire atten-tifs, naguère, à sécréter, jour par jour, un peu de copie sur la Sueur de Sang de la France.
Pourquoi n’avouerais-je pas à mon tour que j’ai les mains peu remplies de ces documents de cannibales, et qu’il a fallu plus de vingt ans pour que je me décidasse à redescendre dans cette cave oubliée des puissants vins de la Mort, où l’ivrogne le mieux éclairé par les projections lumineuses de l’enthousiasme, ne pourrait plus se soûler qu’en tâtonnant ?
La deuxième phase de la guerre franco-allemande qui fut, je crois, ce que l’histoire peut offrir de plus admirablement raté, est surtout demeurée, pour quel-ques assistants de la défaite, l’époque des grandes énergies perdues. Réflexion banale, s’il en fut, jérémiade usée comme un vieux trottoir. Mais il faut, avoir vu crever et pourrir les intrépides condamnés à ne point agir !
Nous agissions bien drôlement, nous autres. L’homme des champs qui nous remorquait dans les ornières et les casse-cou d’une perpétuelle stratégie de reculade ou de repliement et qui, quelquefois, nous mit dans le triste cas d’abandonner à l’avidité germanique un lot plus ou moins précieux de nos excitantes charognes ; – ce vieillard plein de cultures et d’engrais, ne montra pas, un seul jour, la velléité de nous dépenser profitablement. Ce fut grand dommage, car il y avait là, je vous le jure, de vrais garçons arrivés dans leur propre peau, et qui eussent escaladé l’impossible.
L’occasion des fredaines héroïques ne manqua pas cependant. Il ne se passait pas vingt-quatre heures sans qu’un miracle en disponibilité nous sollicitât. Seulement, les prodiges, quoi qu’on ait dit, ne s’accomplissent que par l’influx des volontés supérieures, dans l’étroite voie de l’obéissance, et l’esthétique des téméraires manquait surtout à notre berger.
Rien à faire, par conséquent, sinon de perambuler et de trimarder nuit et jour, par les temps secs ou les temps liquides, à travers cinq ou six provinces. Nous apparûmes çà et là, vermineux et chapardeurs, apprenant beaucoup de géographie départementale et, chaque matin, ravigotés par une ample certitude que, sous un tel chef, les Prussiens nous seraient infailliblement présentés – comme il arriva souvent – dans les circonstances les moins favorables aux salamalecs des moutardiers.
Parmi ceux, en petit nombre, qui échappèrent à l’atroce cocasserie de cette existence, je me souviens d’un individu très rare que nous appelions, entre nous, l’Abyssinien
Je suppose que nos supérieurs lui connaissaient un autre nom. Mais il se disait que sa personne était un mystère, et le fait est qu’on ne put jamais rien savoir sur lui de façon précise.
Certains croyaient avoir entendu dire qu’il avait fait la guerre aux Anglais sous Théodoros, et qu’il avait été l’ami et le compagnon de ce malheureux négus. Cette hypothèse parut si plausible qu’on s’en contenta, et c’est pour cette raison qu’on l’appelait l’Abyssinien.
Je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu’un d’aussi taciturne. Auprès de lui, le silence d’autrui ressemblait à du bavardage. Sa voix, que j’entendis une ou deux fois, paraissait intérieure et ne produisait pas de vibration. On en avait l’âme gelée. Sa politesse était effrayante…
Un jour, au début de cette trop fameuse campagne de résistance, il était venu sur son cheval, s’était enfermé une heure avec notre chef et, depuis ce tête-à-tête mystérieux dont rien ne transpira, il faisait partie du mince groupe de batteurs d’estrade volontaires, équipés et montés à leurs propres frais, dont les panaches exorbitants voltigeaient en avant de notre lamentable colonne.
On était naturellement fort légitimiste parmi nous. Il y avait, s’il faut tout dire, pas mal de fleurs de lis et de cœurs sanglants sur les pectoraux, mais les bons gentilshommes-propriétaires de la Vendée ou de l’Angoumois, accourus dans l’intention de restaurer tous les Capétiens aussitôt après la victoire, durent trouver peu d’écho dans ce compagnon sans panache qui pensait visiblement à autre chose et les éteignait en les regardant.
On le voyait rarement ou milieu d’eux. Quelquefois même on était plusieurs jours sans l’apercevoir ; l’éternelle marche continuait, on brû-lait dix étapes, on avalait vingt villages, et le bruit commençait à se répandre qu’il était mort ou captif, lorsque tout à coup il apparaissait au surgir de quelque fourré, souriant et campé droit sur sa merveilleuse jument noire, qui s’envolait par-dessus l’obstacle au seul clappement de sa langue.
Ah ! les deux magnifiques êtres que cela faisait ! L’origine de la bête était aussi peu certaine que la provenance de l’homme. L’Orient et l’Occident avaient dû se croiser pour la production de cette créature de rêve qui ressemblait à une licorne diffamée dans le blason d’un Hospitalier convaincu de félonie ou de cruauté.
Son maître seul en prenait soin, ayant des yeux autour de la tête pour veiller sur elle quand il s’en éloignait un instant, et le comble de l’audace eût été de s’en approcher sans sa permission.
Une seule fois on le vit en fureur, et quelle fureur ! Un tringlot malchanceux, que l’animal gênait, s’était avisé de le prendre par la bride et de l’écarter assez rudement. Il n’alla pas loin. Notre aventurier, qui buvait à deux pas de là dans un café, ne prit même pas le temps d’ouvrir la porte. Au risque de se couper la figure en vingt morceaux, il s’élança sur le sacrilège par une large baie vitrée dont il creva la glace avec un fracas terrible, et l’accommoda sur-le-champ d’une si fougueuse volée que le pauvre diable dut être porté le soir même à l’ambulance.
L’impétuosité inouïe de cette rafale de colère, chez un homme impassible comme les idoles, donnait à soupçonner une étrange complicité. Il devait y avoir, entre ces deux individus presque fantastiques, de bien singulières histoires de massacres, d’enlèvements, de piraterie, d’épouvante ou de trahison. On ne savait pas, et les conjectures allaient leur train dans la direction présumée de cet Orient d’où ils paraissaient être venus, lequel est aussi effrayant encore, malgré tout, pour les gens d’imagination, qu’au XIIIe siècle où son nom seul terrifiait les pèlerins et les chevaliers.
Rien de plus troublant que la beauté de cet homme, qui tenait à la fois de l’éphèbe et du templier, et dont le sourire équivoque était célèbre jusque dans l’armée allemande où il était parvenu à ranimer des superstitions aussi anciennes que les Niebelungen.
Les Bavarois tiraient dessus tant qu’ils pouvaient, mais sans espoir de l’atteindre. On racontait de lui, entre autres choses, cette folie surnaturelle de son intrusion dans un village occupé par deux mille hommes, pour le seul plaisir de pénétrer à cheval dans une maison formidablement gardée, où il avait décrété, comme eût pu le faire un dieu, qu’un certain colonel wurtembergeois recevrait, à deux heures de l’après-midi, un épouvantable soufflet de sa main gantée. On ne comprit jamais comment il avait pu sortir de la fournaise.
Les récits de ce genre étaient à peu près sans nombre et on sut que l’ennemi avait offert de très fortes sommes à des paysans, pour qu’ils le livrassent vivant ou mort.
Il faisait ainsi la guerre pour son propre compte, parfois même avec une férocité diabolique, et, lorsqu’au moment de l’armistice, il disparut pour ne jamais revenir, on pensait chez nous qu’il avait bien pu tuer, de sa main, trois ou quatre cents Allemands.
Voilà tout ce que j’avais à raconter. Par condescendance pour messieurs les Psychologues, j’insiste sur ce point, à peine effleuré, que mon Abyssinien prétendu avait à peu près le visage d’une très belle fille infiniment voluptueuse et aussi dénuée de courage qu’on peut l’être sous le soleil. Il eût ravagé, dévasté facilement et profondément des enfants et des vieillards.
Or c’était un amoureux de la Guerre, quelle qu’elle fût. Il avait la concupiscence exclusive de l’égorgement.
Malgré la distance, je le vois encore, pâle et rouge comme une prostituée, dans sa pelisse de Magyar ou de favori du Padischah, les dix doigts pavés de pierres précieuses et, du haut de son destrier fabuleux, vous regardant – avec un sourire d’une langueur inexprimable – de ces yeux couleur de plomb, de ces terribles yeux d’aveugle jouisseur, d’où ne sortait jamais un rayon pâle,- au fond desquels se cachait très soigneusement la Mort.