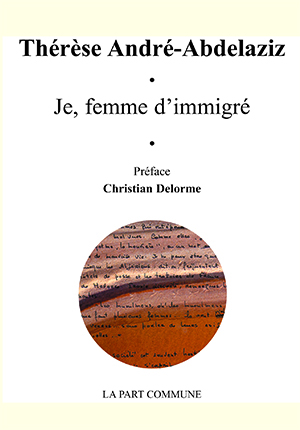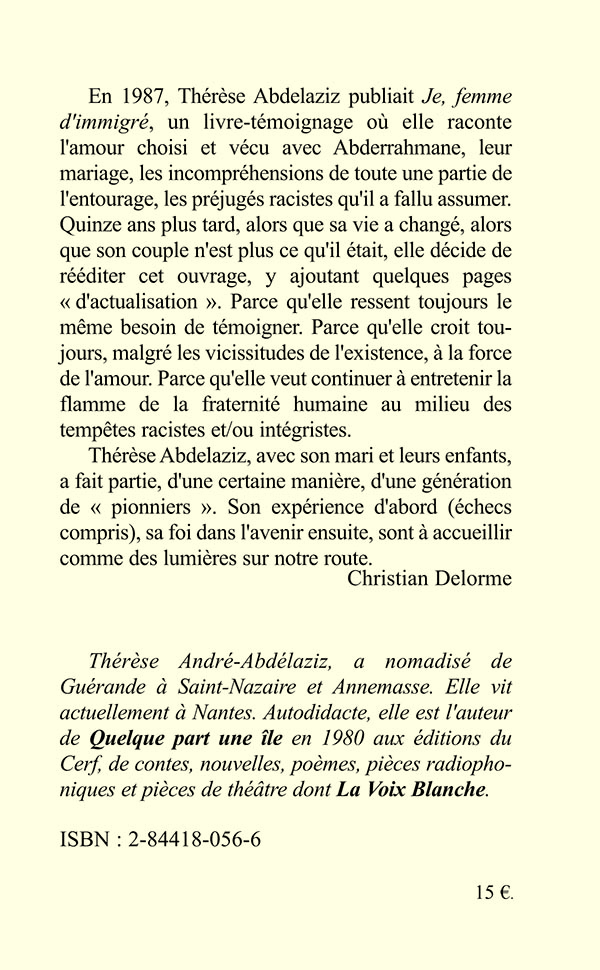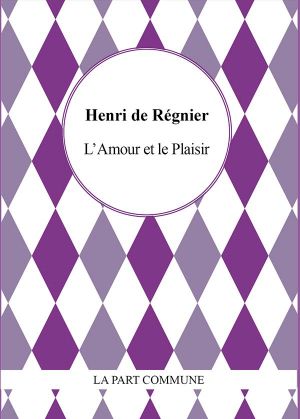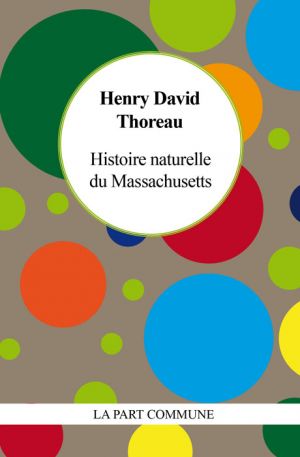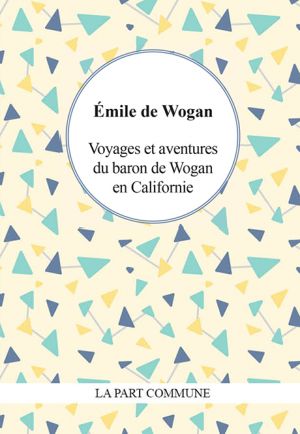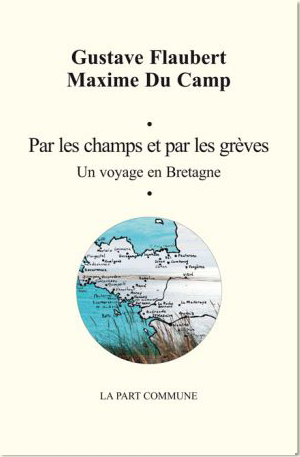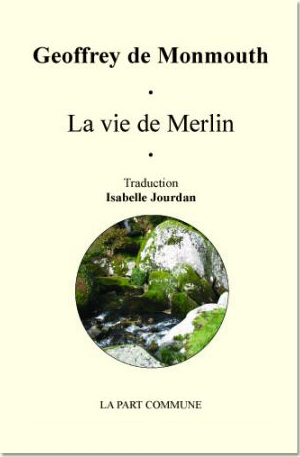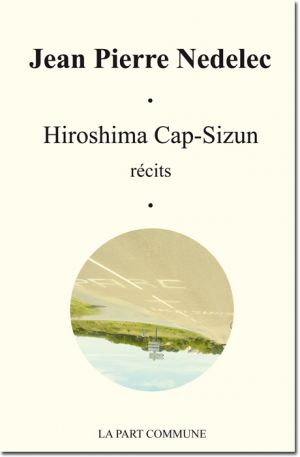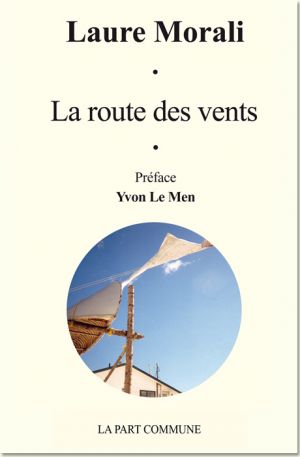Un jour, ma vie croise celle d’Abderrahmane. C’est un dimanche de l’été 1958. Ce sera l’été et ce sera dimanche pendant longtemps.
À Saint-Nazaire, tout le monde l’appelle « Raymond ». Il l’a voulu. Plus tard, j’apprends que c’est à cause de la guerre : on peut se cacher derrière un prénom, c’est un paravent qui permet d’agir dans l’ombre et d’être insoupçonnable. « Raymond » travaille dans un garage, à l’atelier. C’est un garçon très estimé. Peu bavard, il a pourtant une certaine présence et un charme que beaucoup lui envient. Je suis tout de suite attirée par son regard et par son sourire : ils le transfigurent. Sa voix est un feu qui m’embrase. L’amour ne peut avoir d’autre visage que le sien. Bientôt, je me surprends à guetter son apparition, chaque soir, quand il traverse l’avenue de la République sur sa vieille bécane pour me rejoindre après le boulot. On s’étreint, on s’embrasse, on se promène bras dessus, bras dessous, on se chuchote des choses banales qui prennent soudain de l’importance. Au milieu de cette guerre, nous oublions tout ce qui devrait nous éloigner. Les mots, les expressions familières de Raymond me font sourire : il a un drôle d’accent, tout rond. Quelquefois, j’écoute à peine ce qu’il dit, je regarde seulement ses lèvres tandis que nos mains, sur le guidon qui nous sépare, se cherchent, se perdent et se retrouvent.
Moi qui ne suis jamais sortie avec un garçon, je n’hésite pas à me montrer avec lui, Abderrahmane. En ces temps troublés où rien n’est simple, nous ne prenons aucune précaution particulière, nous nous montrons au grand jour.
Mon ignorance de l’Algérie, de ses coutumes, l’amuse. Il m’apprend les gestes quotidiens de son pays : la façon d’ouvrir une orange avec douceur en écartant l’écorce taillée de haut en bas, de prendre de l’eau dans ses mains réunies, de se laver le visage, la bouche, les narines et les oreilles avant de dire les prières rituelles. Je veux tout savoir, tout connaître de l’Algérie. Je l’écoute parler des montagnes de chez lui, de l’allée bordée d’eucalyptus et du marché qui se tient sur la colline, à Taher, son village du Constantinois. J’épelle son prénom algérien le soir, avant de m’endormir. Je le répète dans la journée, tout bas, dans ma tête. Je l’égrène pour le plaisir.
Raymond n’oublie pas les siens. Son père, Omar ben Chérif, un commerçant très pieux, intègre et bon. Sa mère, Kremfila ben Abid, une femme vive et dynamique, à laquelle il ressemble beaucoup. Son frère, Madjid. Hanifa, Salima et Sakina, ses sœurs. Son proche parent, Ferhat Abbas, dont de Gaulle se souviendra dans ses mémoires.
Nos bavardages, nos rires et nos promenades le long du port font reculer la guerre pour quelques heures. Nous vivons comme si les prochaines saisons devaient nous apporter la paix. Nous affichons notre bonheur. Les gens que nous croisons nous regardent peut-être de travers, nous n’en avons cure. Une espèce de grâce nous habite, nous en sommes conscients.
Je me dis quelquefois que c’est trop beau, cet amour qui nous lie. J’ai peur de le voir s’effriter, un soir ou un matin, sans que nous y prenions garde. Mais un geste, un regard de Raymond suffisent à balayer mes appréhensions, et je profite de ce temps qui nous appartient.
Ma famille apprécie ce jeune homme que je leur ai présenté. Il a plu immédiatement à ma mère : « Il a un si beau sourire, des dents si blanches, une telle délicatesse… » Et mon père aime le « gagner » aux dames ou aux dominos. Quant à mes frères et sœurs, ils exultent ! Un aîné de plus, c’est formidable !
Très vite, nous envisageons le mariage. Raymond fait sa demande dans la cuisine. C’est un jour ordinaire. Maman, comme d’habitude, s’affaire devant l’évier. Les mains savonneuses, le tablier constellé d’eau de vaisselle, elle nous observe un moment avant de répondre que je ne suis pas encore majeure et qu’il conviendrait d’en aviser mon père. Au ton de sa voix, je sens que la partie est gagnée.
Nous ne nous quittons presque plus. J’apprends à connaître la religion musulmane et son fondateur, Muhammad, que la langue française déforme en Mahomet.
« Cette appellation est impropre, dit Raymond. Il faut l’éviter. »
Je me lance dans la lecture du Coran. Raymond, de son côté, ne m’a pas attendue pour étudier les évangiles. Il s’y intéresse depuis longtemps. Nous confrontons nos pensées, nos doutes. Nous les nourrissons de nos recherches personnelles, de notre démarche, de notre foi.
« Sers Dieu comme si tu le voyais ; si tu ne le vois pas, Il te voit », professe le croyant musulman qui se veut, avant tout, témoin de Dieu. J’approche de très près le conscience religieuse des fidèles du Prophète. J’admire leur sens d’une présence divine qui enveloppe tout, pénètre tout, qui agit en tout. Ils l’expriment dans les formules et les actes de la vie courante. Ces ouvriers nord-africains si décriés, je les côtoie grâce à Raymond. Ils vivent leur foi d’une façon profonde et sincère qui me bouleverse. La mienne est si tiède ! Beaucoup savent le Coran par cœur. Au travail, à l’usine ou dans les carrières, ils méditent en silence pendant que leurs mains s’activent sur les machines…