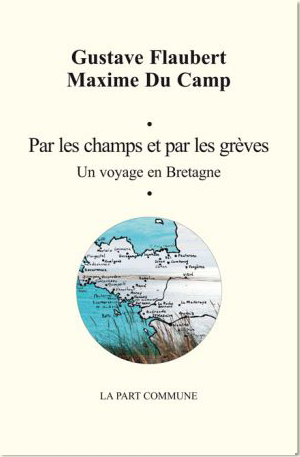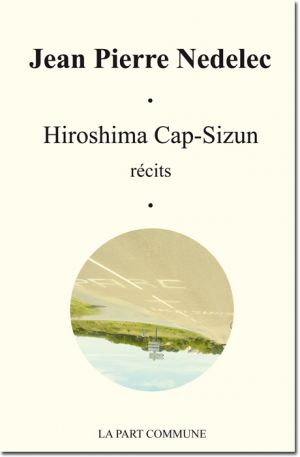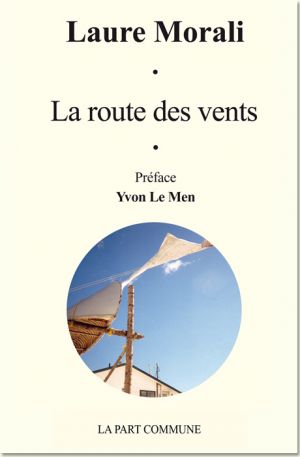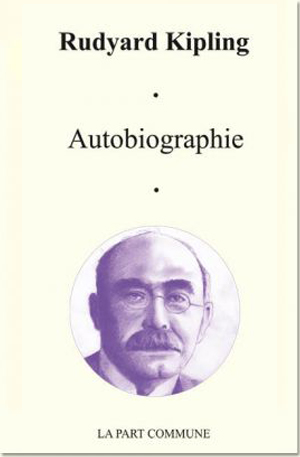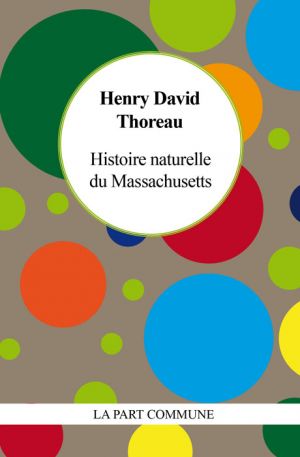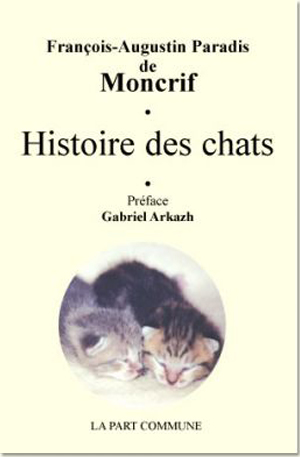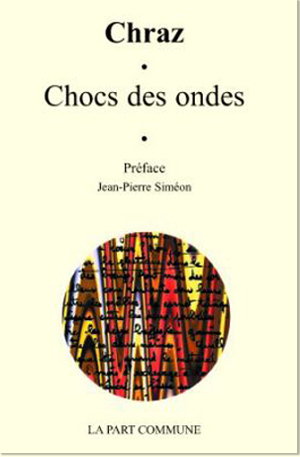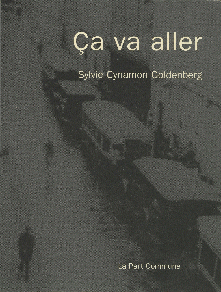Le samedi 1er mai 1847, dès potron-minet, deux jeunes hommes se rendent à pied de la Madeleine à la Gare d’Orléans, pour y prendre le train pour Blois, point de départ d’un voyage dans le « Grand Ouest » français qu’ils ont décidé d’entreprendre. Maxime Du Camp, qui a alors vingt-cinq ans, est le fils unique d’un chirurgien parisien et a entrepris des études de droit, sans grande conviction, puisqu’il se destine à la carrière des lettres. Gustave Flaubert est de deux mois et demi son aîné ; venu de sa Normandie natale et lui aussi fils d’un chirurgien, il avait entrepris des études de droit à Paris, en 1841, sans plus de conviction que son futur ami, avec lequel il partage le goût de la chose écrite.
Tous deux se sont rencontrés en mars 1843, dans l’appartement d’un ancien condisciple de Flaubert, Ernest Le Marié, dans l’Île de la Cité. Du Camp était « charmant, quoique plutôt laid, grand, très élégant, la taille mince et cambrée, une chevelure brune abondante », et Flaubert, « avec une longue barbe blonde et le chapeau sur l’oreille » ressemblait « aux jeunes chefs gaulois qui luttèrent contre les armées romaines ». Les deux hommes sympathisèrent immédiatement, même si chacun ne tarda pas à voir le défaut majeur de l’autre qui, à lui seul, eût dû être rédhibitoire à leur amitié : Gustave ne pouvait ad-mettre l’ambition affirmée de Maxime, qui lui-même s’agaçait des farces potaches du premier. Nul doute que ces traits profonds de leurs caractères contribuèrent à leur séparation.
Au tout début de l’année suivante, après une crise d’épilepsie, Flaubert renonce au droit et retourne vivre en Normandie, à Rouen d’abord, puis à Croisset sur les bords de la Seine où il entreprend la première version de L’Éducation sentimentale. Les deux amis s’écrivent abondamment, se revoient quelques fois, Du Camp allant rendre visite à Flaubert. L’année 1846 marque un véritable tournant dans la vie de ce dernier qui perd, coup sur coup, son père et sa sœur qu’il adorait, et rencontre dans l’atelier du sculpteur James Pradier, celle qui deviendra sa maîtresse pendant dix ans environ d’une liaison tumultueuse, Louise Colet. De son côté, Du Camp, grâce à la fortune qu’il a héritée de son père, mort alors qu’il n’avait que deux ans, entreprend ses premiers voyages en Europe et en Orient.
C’est dans ce contexte que germe dans l’esprit des deux jeunes gens l’idée de ce voyage en Bretagne qui, à cette époque, reste encore une terra incognita, que Du Camp décrit comme « un pays relativement éloigné et resté un peu en dehors de la civilisation par ses mœurs et par son langage ». Flaubert, tout casanier qu’il fût, ne rêvait que de voyages, et celui-ci ne devait être, quand bien même ils en firent une grande partie pedibus cum jambis, qu’un galop d’essai avant de plus lointaines expéditions. Il ne dissimule d’ailleurs pas son enthousiasme, quand il écrit, trois jours avant le départ, à son ami Ernest Chevalier : « J’ai besoin cependant de prendre un peu l’air, de respirer à poitrine plus ouverte et je pars avec Du Camp nous promener sur les grèves de Bretagne, avec de gros souliers, le sac au dos, à pied. Nous reviendrons à la fin de Juillet ». De surcroît, son médecin, le docteur Jules Cloquet (ancien élève du père de Flaubert, qui avait accompagné Gustave en Corse, en 1840) lui recommande d’entreprendre ce voyage à travers la Bretagne pour le « distraire » de sa maladie et de ses tourments. Mais Mme Flaubert mère s’y opposa d’a-bord, avant d’y consentir à condition qu’elle puisse rejoindre les deux jeunes voyageurs pour veiller sur eux – fort heureusement, elle ne les retrouva qu’entre Brest et Saint-Malo, à la fin de leur périple, et non à Vannes, une des premières étapes de leur expédition, comme cela avait été initialement prévu.
Avant de partir, Gustave et Maxime ont décidé de prendre des notes et de tenir une sorte de journal de voyage à quatre mains, qu’ils retravailleraient à leur retour pour publication, Flaubert étant chargé des chapitres impairs et Du Camp des chapitres pairs. Rien ne semble précisément décider de ce découpage en chapitre, qui ne correspond ni à des épisodes particuliers de leur périple, ni à des étapes importantes de leur circumambulation bretonne. Mais les préparatifs avaient été longs et studieux, car avant de partir, ils se plongèrent dans de nombreux ouvrages traitant de l’histoire de la Bretagne, d’archéologie et de la culture celte. C’est donc fort de ce bagage savant que Flaubert et Du Camp se mirent en route, et le récit de voyage qu’ils composèrent porte la trace de ces précieuses lectures, mâtinées du goût de l’amplification littéraire du premier et du ton docte du second, tous deux possédant, cependant, ce sens des choses vues si cher à Hugo.
Pendant deux mois et demi, dans une véritable communion d’amitié, Du Camp et Flaubert se baguenaudent, havresac au dos, en ne suivant pour tout itinéraire que celui où les porte leur instinct. Cette province ne cesse de les surprendre par son folklore, sa religiosité et sa langue. Et si le terme de leur voyage consiste en une sorte de pèlerinage à la gloire pré-posthume du grand homme, Chateaubriand, il marque comme le retour à une civilisation connue après plusieurs semaines d’immersion dans une Tartarie d’Extrême-Occident, comme Flaubert l’écrit à son ami Ernest Chevalier, le 13 juillet : « Nous terminons (hélas !), Max et moi, un voyage qui pour n’être pas au long cours, ce que je regrette, a été une fort jolie excursion. Sac au dos et souliers ferrés aux pieds nous avons fait sur les côtes environ 160 lieues à pied, couchant quelquefois tout habillés faute de draps et de lit et ne mangeant guère que des œufs et du pain faute de viande. Tu vois, vieux, qu’il y a aussi du sauvage sur le continent », en concluant : « Et puis la mer ! la mer ! le grand air, les champs, la liberté, j’entends la vraie liberté, celle qui consiste à dire ce qu’on veut, à penser tout haut à deux, et à marcher à l’aventure en laissant derrière vous le temps passer sans plus s’en soucier que de la fumée de votre pipe qui s’envole ».
Par les champs et par les grèves – Un voyage en Bretagne
Avant de partir pour un voyage en Bretagne qui, à cette époque, reste encore une terra incognita, Gustave Flaubert et Maxime Du Camp se plongèrent dans de nombreux ouvrages traitant de l’histoire de la Bretagne, d’archéologie et de la culture celte. C’est donc fort de ce bagage savant qu’ils se mirent en route, et le récit qu’ils composèrent porte la trace de ces précieuses lectures.
Au terme du voyage, Flaubert écrit à son ami Ernest Chevalier : Sac au dos et souliers ferrés aux pieds nous avons fait sur les côtes environ 160 lieues à pied, couchant quelquefois tout habillés faute de draps et de lit et ne mangeant guère que des œufs et du pain faute de viande. Tu vois, vieux, qu’il y a aussi du sauvage sur le continent », en concluant : « Et puis la mer ! la mer ! le grand air, les champs, la liberté, j’entends la vraie liberté, celle qui consiste à dire ce qu’on veut, à penser tout haut à deux, et à marcher à l’aventure en laissant derrière vous le temps passer sans plus s’en soucier que de la fumée de votre pipe qui s’envole ».
________________________________________
Format : 12×17
Nombre de pages : 608 pages
ISBN : 978-2-84418-214-2
Année de parution : 2010
18,00 €
| Poids | 300 g |
|---|---|
| Auteur |
Flaubert Gustave / Du Camp Maxime |
| Éditeur |
Collection La Part Classique |