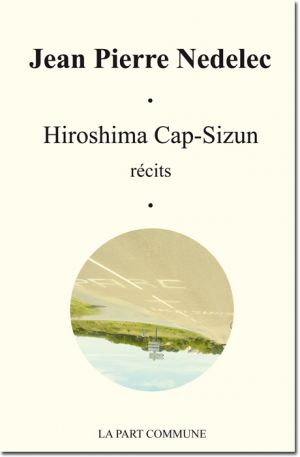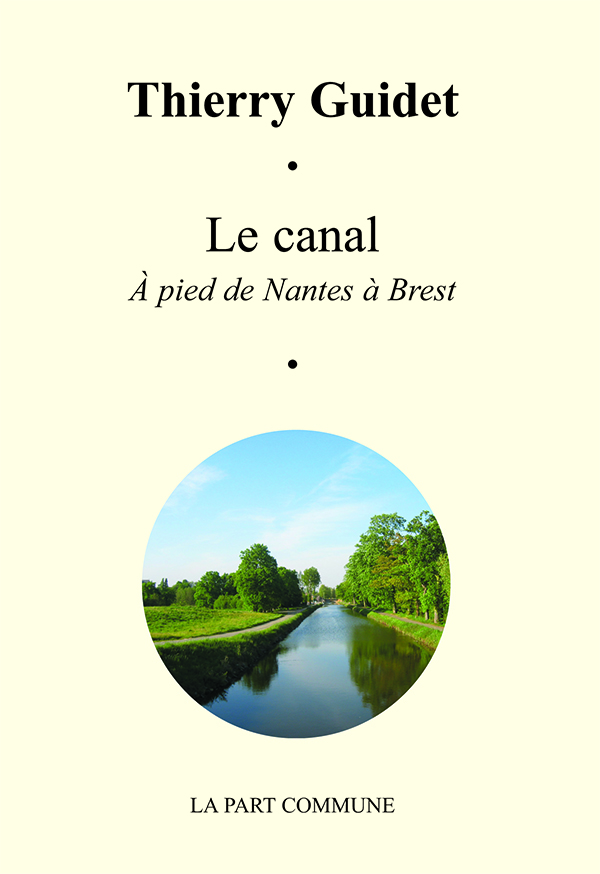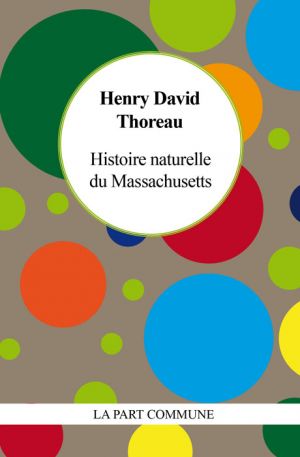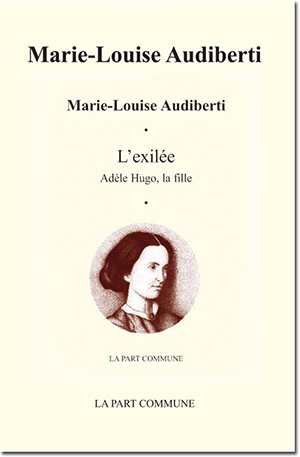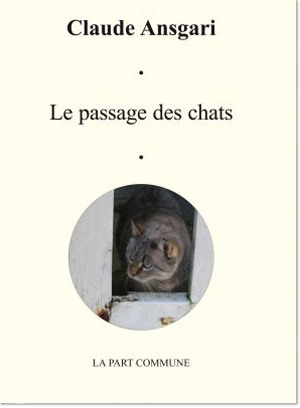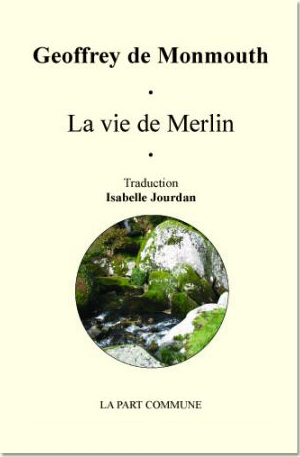La lettre
Dès que je tins l’enveloppe entre les doigts, je sus que c’était lui. Il ne s’y était encore jamais risqué. Je ne me rappelais pas l’avoir vu écrire. Je me demande même aujourd’hui, si, à l’appel de mon nom, je n’ai pas pressenti que, pour la première fois, mon père m’avait écrit.
Nous savions qu’il était passé par l’école. Ce qui ne fut pas le cas de sa mère. La légende familiale prétendait qu’elle s’y était assise une semaine. Nous disions, pour je ne sais quelle commodité : huit jours. Et bien qu’elle eût pour moi ces petits mots d’affection – Jean Pierre ma vaotig vihan – l’accompagnait une réputation tenace de dureté, aussi bien pour elle que pour les autres, au point que la tribu entretenait ce feu mesquin : huit jours, pas assez pour apprendre le français, mais largement pour savoir compter.
Bien qu’étant plutôt de nature dispendieuse, j’aime l’épithète qu’on lui affectait si naturellement : pizh… Pizh eo vamm, Mamm zo pizh…Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle ne jetait pas l’argent par les fenêtres. Pizh ! Je pourrais transmettre, (vous préféreriez traduire ; non, transmettre) essayer de transmettre par économe, ou radin ; faut-il aller jusqu’au repoussant avare ? Il me semble que le mot, dans la manière dont je l’interceptais, pouvait s’accommoder tantôt de l’un, tantôt de l’autre, selon les témoins, les situations, et probablement les circonstances météorologiques. Dans l’émission de ce pizh, on sublimine que le pouce rejoint l’index, tâte et pèse les piécettes, sou par sou, pour s’assurer du compte juste, et qu’il sera possible de pourvoir au nécessaire le lendemain. On est pizh par nécessité, en quelque sorte ; parce qu’il s’en faudrait de peu pour verser dans la vraie pauvreté.
Ce que mon père retenait de l’école, ce n’était pas tant le souvenir du sabot – infamant – ou de la pièce percée qu’il fallait se glisser d’une bouche à l’autre, quand on était pris en faute de parler sa langue, mais ces moments de simple plaisir consacrés à l’arithmétique et au calcul mental. Compter n’exigeait pas une maîtrise parfaite de cette langue étrange qu’on n’entendait qu’à l’école. Ces humiliations quotidiennes les imprégnèrent au point d’engendrer l’oubli. La blessure se fit attendre.
Elle vint au moment du Certificat. De la Dictée. Le certificat d’études ! – Dois-je vous resituer le contexte ? Nous sommes en 1923, 1924. Au lendemain de la plus belle boucherie que l’Occident s’est auto-offerte. Ça franchouille à fond de tous côtés. On a retrouvé l’Alsace et la Lorraine, et tu peux être sûr qu’on va leur apprendre le français à ces contaminés des Teutons. Au point que cinq fautes dans la dictée et vous étiez recalés du certif…
La petite phrase assassine, mon père ne l’a jamais oubliée. Il faudrait que vous l’entendiez, que vous la mâchiez, que vous l’écriviez à votre tour avant que je ne vous la livre, que vous la lisiez, puisque ce sera , je l’entends déjà : mais c’est bien sûr n’est-ce pas, c’était si simple, comment n’y avaient pas pensé ces petits bouseux…Dîtes-le ! Allez dîtes : ces invités, en bout de table, de la République !
Il la citait de mémoire, cette phrase qu’il n’avait pu inventer, où je retrouvais l’écho de tous les pièges auxquels nous étions nous-même soumis, par cet étonnant obscurantisme pédagogique, marabouté par l’idéologie (oui !) persistante de la faute.
Combien de fois j’entendis mon père, comme on caresse la cicatrice sensible au bout du doigt entaillé jadis, déclamer ce passage, que nous reprenions en chœur, dépositaires de cette blessure mémorielle, drainée par la solidarité du maigre clan. Tout comme lui, nous n’en revenions pas de cette offense, dont furent victimes des petits paysans qui n’ignorent pas que, si le printemps dégouline, l’ail nouveau s’étiole dans l’argile gorgée d’eau :
Il avait tellement plu cette année-là que les aulx en manquèrent.
Trente ans plus tard, mon père en était encore effaré. Je buvais son incompréhension et la muait peu à peu en révolte. S’il n’y avait eu que les aulx, s’étonnait-il, mais ce en – que faisait là, en effet, ce en alambiqué, dont la seule présence témoignait d’un maniérisme, placé à la bourse des salons, avant que le cours n’en fut rapidement déprécié. Bien plus tard, j’eus le sentiment de prendre, pour mon père, une bonne revanche, en lisant comment Léautaud pointait ce en parasite et disgracieux chez Valéry, et même chez Gide, pour en tirer quelque trait où la charité ne fut jamais admise.
Quand il avait, pour la première fois rejoint l’école, sans doute en 1917, à quelques mots près, mon père ignorait le français, qu’il apprit donc en immersion, méthode que rejettent aujourd’hui tant d’activistes jacobins, dépensant une énergie si peu citoyenne pour entraver l’apprentissage du basque, du breton, du corse, probablement du flamand, dont l’usage n’a pas disparu aux alentours de Steenvoorde.
Encore en immersion, et pour cause, mon père apprit les rudiments d’une troisième langue, l’allemand, pendant les années de captivité.
C’était toujours ma mère qui m’écrivait. Large écriture, où l’usage récent du stylo à bille n’avait pas nui à l’élégance des rondes. Tantôt j’attendais, tantôt je craignais ses lettres. Elle aimait écrire Mon fiston, et m’assurait la chronique des jours ordinaires, que la barrière des hauts murs de cet ancien collège de Jésuites érigeait en autant de merveilles. Je les craignais, puisqu’elles furent nombreuses écrites avec rage, en coup de sang, le jour même où parvenait à l’adresse parentale l’avis que le fiston, eh oui ! Encore une fois, serait collé dimanche prochain, et donc le samedi. Et il y en eut de ces billets de colle, bien au-delà du raisonnable…
Parfois j’allais au devant, puisque j’avais la certitude, non pas de la sanction, mais de l’injustice. Je savais aussi que le pli du lycée
Madame, Monsieur,
J’ai le regret de vous informer que votre fils….
Est l’objet d’une sanction…
Consigné le…
Motif…, etc…
entraînerait des heures pénibles à la maison, pour mes sœurs et mon père, malmenés par la tyrannie d’une mère, qui, qu’elle qu’en fut la violence, protégeait malgré tout ce fils chéri, au point de s’abaisser parfois à frapper à certaines portes, pour tenter de parer aux pires effets auxquels l’inconséquent boursier prêtait si souvent le flanc.
J’étais assuré chaque semaine d’une lettre affectueuse, mon fiston ; elle m’allait bien. Plus que tout, je craignais la seconde : mon fils ! solennelle, me confirmant qu’à la distribution du jeudi matin elle avait, une fois encore, été poignardée. Elle n’avait pas besoin de décacheter. De ma prison scolaire, je l’imaginais bien, la tempête emportant la tribu soumise à sa folie, sa misère, son malheur sans doute. Il suffisait de l’en-tête du lycée.