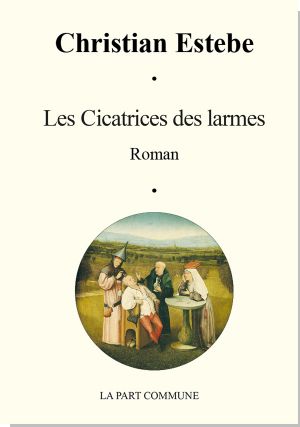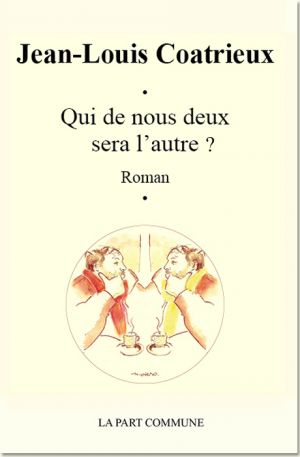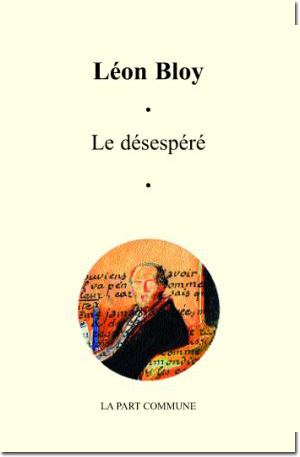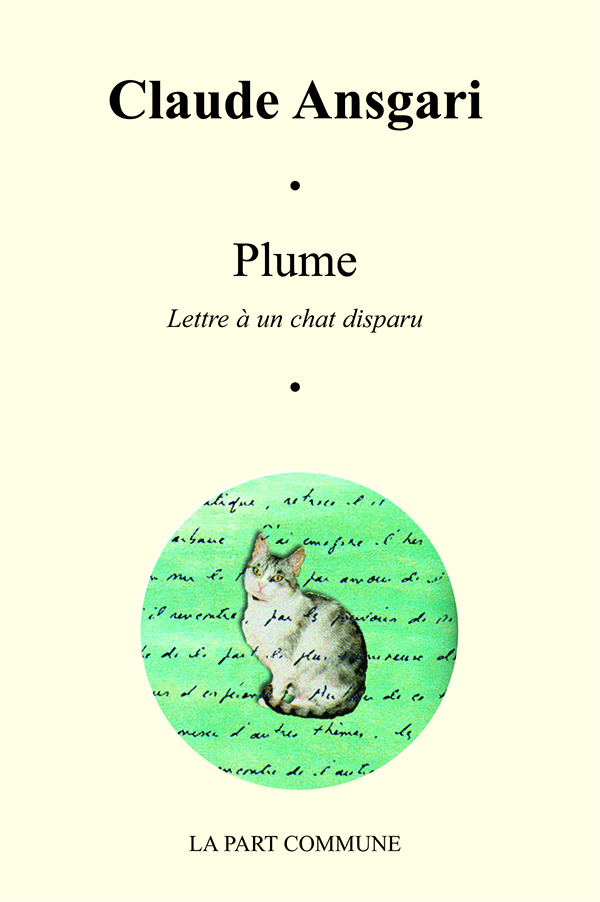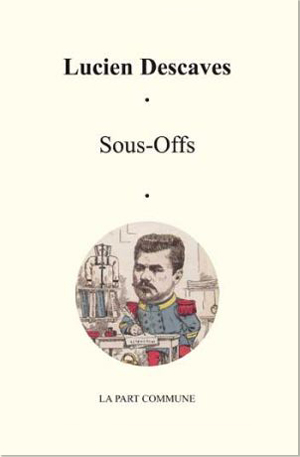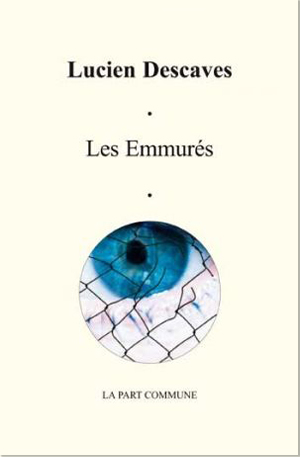Partie 1
L’empreinte
1
Vingt ans, tout au plus. C’est par la droite que cela se poursuit. Un sweat à capuche me déborde sans que je n’arrive à percevoir le visage à l’intérieur. Le pas est rapide, alerte. Il sautille d’un pavé à l’autre quand le mien semble s’enfoncer à chaque fois. Un arrêt brusque me permet de me rapprocher mais le redémarrage tout aussi prompt me remet à distance. Premier jour, premiers pas. Le corps n’est pas encore rompu au bon tempo. Un manque d’anticipation et de réflexe. Dans un reflet de boutique, je cherche à distinguer les traits du visage. Je ne suis même pas certain du sexe. À l’angle de la rue du Renard, son profil s’inscrit enfin dans la lumière. Un visage tout neuf. Une lycéenne. Je me demande si je peux l’inclure dans l’étude. Elle remise son sac sur l’épaule et accélère de plus belle. Elle s’engouffre sous les arcades et réussit encore à presser le pas à la vue du bâtiment qui doit être son lycée. Un portail automatique sectionne notre fil et je la perds de vue. Je sors une carte, hésite à consigner ce trajet de quelques hectomètres. Tout voyage mérite-t-il une trace ? Une impression particulière ? Je réalise que, de toute façon, je n’ai pas eu le temps de prendre la photo. Je comptabilise, tout en réfléchissant, les visages qui entrent dans mon champ de vision. J’attends le troisième pour repartir, la carte vierge entre les mains.
Le même portail s’efface pour laisser paraître une femme plus âgée, comme si, faille temporelle, la lycéenne avait troqué son sac contre trente années de plus. La démarche est tout aussi assurée, ample, régulière. Assumée. Une femme qui se tient droite marche en cherchant le regard ou plutôt les regards sur elle. Ses talons martèlent les pavés et sa progression ainsi rythmée dans les ruelles du centre invite les autres à ralentir. Elle aussi s’arrête et se retourne subrepticement. Est-elle gênée par ma présence ? Elle donne l’impression d’avoir tout deviné déjà, de voir à travers moi. Elle reprend sa marche et moi la mienne à sa suite. Elle franchit la porte de la vieille ville. Une sensation s’installe. Un frisson.
Je m’identifie à Jean-Pierre Léaud dans le film Baisers volés de Truffaut, intrigant maladroit, détective malhabile. En moins cabotin : ça, je n’ai jamais su faire. Je préfère convoquer cette image-là plutôt que de reconnaître que je suis les gens, moi qui trouve déjà difficile d’être moi-même.
À la sortie de la vieille ville, la femme s’arrête de nouveau. Sort des clés de son sac, se tourne une dernière fois dans ma direction et ouvre une porte en bois qui l’oblige à se baisser avant de la franchir. Comme souvent, mon imagination galope à tout-va mais mes pieds refusent de bouger. Je patiente quelques instants dans cette ruelle vide, déçu de ne poursuivre l’aventure avec elle. Je lève la tête des pavés, cherche le passage du soleil. Au-dessus des maisons à colombages, dans ce quartier qui a résisté aux incendies et aux bombardements, dans ce quartier resté debout à travers les siècles, se dresse fièrement, au loin, la tour H.
2
La tour H est un édifice impressionnant, la star de son époque, une structure géométrique composée de deux cylindres, dont les formes arrondies évoquent, vues du ciel, une lemniscate, cette courbe plane, symbole d’infini. Cette tour est le phare de la ville qui, placée trop loin des côtes maritimes, n’en possède pas et, si aucun rayon lumineux n’en sort véritablement la nuit pour éclairer la cité, il reste toujours et à n’importe quelle heure une lumière allumée, une veilleuse, pour aider les passants à retrouver leur chemin. C’est le point le plus haut, le repère incontournable de la cité. On se définit par rapport à elle : on est du nord ou du sud, à proximité ou à l’opposé, dans sa lumière ou dans son ombre. Mais ce n’est pas ça qui m’incite à capturer régulièrement son image, ce n’est pas sa forme atypique ou sa taille impressionnante qui m’attire, ni sa force et cette impression d’autorité qui s’en dégage, ni même encore la place qu’elle a prise dans la ville, non, les indices que je cherche à chaque fois, les traces que je traque en elle sont celles de la masse organique qu’elle abrite – masse dont je fais partie – cette présence discrète mais permanente de ses occupants, ce flux incessant qu’elle prend soin de relâcher et d’absorber par petits groupes ou par vagues entières, au rythme des montées et descentes des cages d’ascenseurs, du matin au soir et jusque tard dans la nuit. La tour ne dort jamais, ne se repose pas, ne s’est pas arrêtée une seconde depuis le jour de sa naissance pour une raison évidente : la tour est vivante.
Je prends soin de bien l’observer à différentes heures du jour et de la nuit, moi qui, à la paresse, me permets le luxe d’ajouter l’insomnie. Il y a toujours un appartement éclairé, toujours une vigie pour monter la garde, pour regarder qui à l’est, qui à l’ouest. Cinq cents logements dissimulent une foule diffuse, une foule rendue discrète par le volume de la structure, mais une foule que l’on devine à cette tour qui tressaille, qui vibre – certains prétendent que c’est le vent mais je connais, moi, la vraie raison de son oscillation – et bouge comme dans une manifestation populaire. Je suis fasciné par cette masse compacte, aux éléments si proches et si distants à la fois. Moi-même qui la fixe au moment d’appuyer sur l’obturateur, imaginant toutes ces vies autres que la mienne, qui ne me dit pas que de l’autre côté, depuis un étage de la tour ou depuis le toit-terrasse, au même moment, un autre désœuvré, habité par les mêmes pensées, n’a pas sorti son petit appareil pour fixer, lui aussi, cet instant avec ce subtil contrepoint : un apitoiement pour ma pauvre personne qu’il peine à discerner au fond du square faiblement éclairé au pied de la géante.
À mon arrivée en ville, dans ce tourbillon de nouveautés, la tour H m’a rassuré. Comme si j’avais retrouvé une vieille connaissance. J’habite cette tour depuis mon retour. J’en ai fait la condition première de sa réussite. J’ai même réintégré l’appartement quitté vingt ans plus tôt. J’ai bouclé la boucle, repris l’appartement du départ comme si, après avoir construit une vie en dérivation, j’avais renoué le fil de mon existence initiale. De retour à ma table d’écriture, je suis de retour à ma place, à celle où, pour moi, tout démarre toujours.