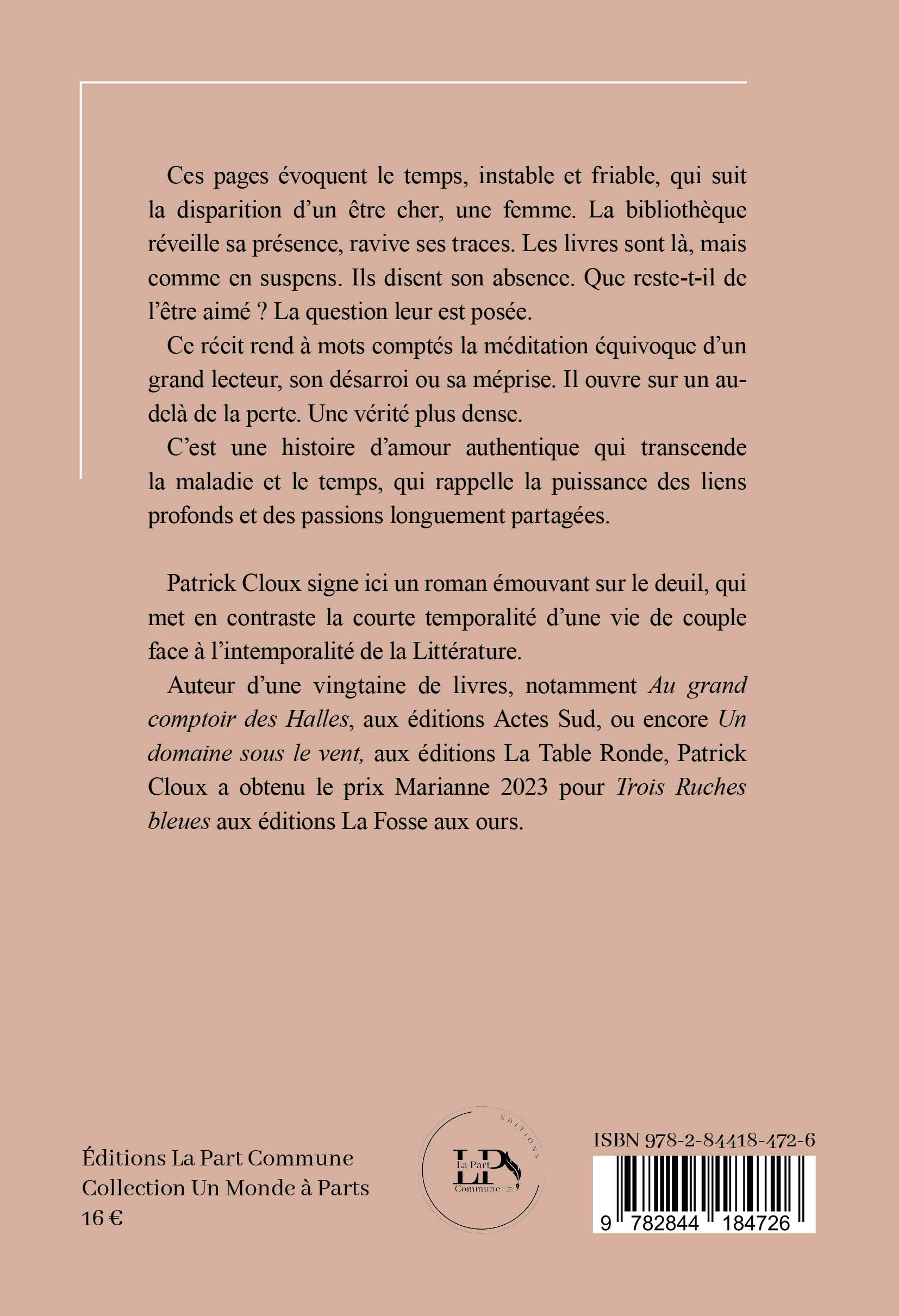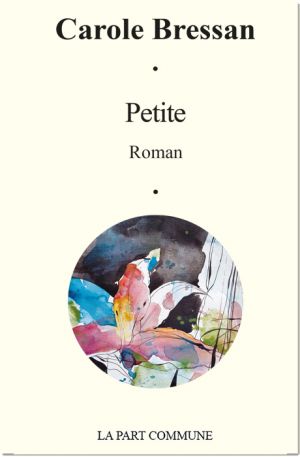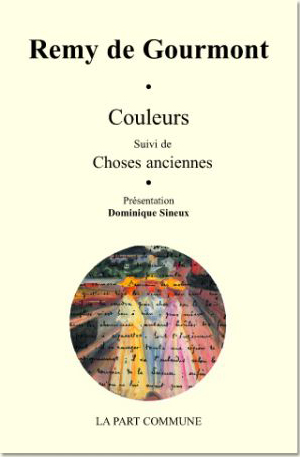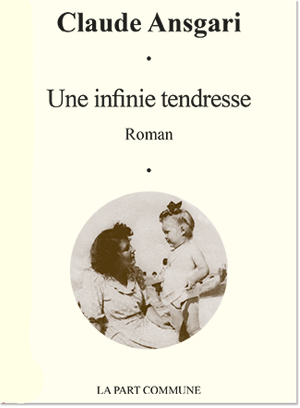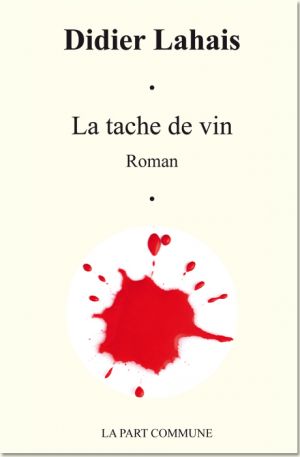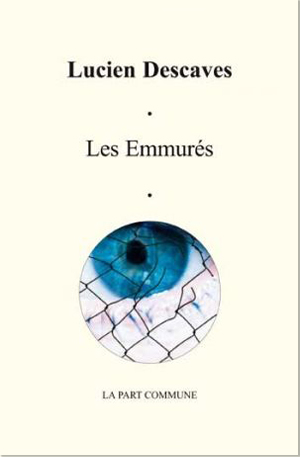Cet été fut particulièrement long et difficile. La sécheresse, comme un front de guerre totalement inconnu de nous gagna de toute part du terrain. Dans la mare devant la maison l’eau ne cessait de s’assombrir, s’envasant par endroit, ne laissant qu’un faible réduit aux alevins et aux carpes. Les plus grosses nageaient de biais pour éviter la boue. Une odeur de fange arrivait vers le soir. Ce qui augmenta notre angoisse. Gênées, empêtrées par ce manque de place, les carpes se regroupaient très en-deçà de leurs parcours. Cela m’attristait de les voir faire. Moi, qui d’habitude tiens au fil de l’été plusieurs fers au feu, je me sentais sans énergie. Peu à peu les arbustes les plus fragiles séchèrent sur place. Des buis grillèrent sur pied. On n’avait jamais vu ça. L’air brûlant des débuts d’après-midi nous punissait. Je compris physiquement ce que devaient connaître sur de longs mois les pays tancés par le soleil. La verdure est un don du ciel. On ne remercie jamais assez dans notre monde où tout semble donné. L’eau, la fraîcheur, la pluie heureuse, le bleu du ciel, l’hallucinant bonheur des nuits claires. Ma compagne, comme les poissons, suffoquait à son tour, malmenée par un cancer en cette chaleur terrible. Cet été fut pour nous profondément angoissant et pénible. Et nous espérions cependant, poursuivant l’envie classique de croire aller mieux lorsque surviennent les beaux jours. L’air lui manqua terriblement, la maladie avançant lourdement en elle. Novembre apporta ses premières ondées molles et médiocres. L’herbe redevint par endroits plus verte, tu semblais aller mieux. Une sorte de palier d’apaisement reconstruisait nos jours. Puis le gel et la neige déboulant sans prévenir, on se réfugia dans ce qui restait d’étrange et de vivant dans nos sarments de chair. Cela suffit un temps à nous calmer. Un autre froid te prit en son raidissement. Ma courageuse aux dix-mille nuances devait rejoindre un ciel sans nuage. Janvier éteignit brusquement sa lumière. Au cœur vivant de ma douleur, face à cette corruption de notre longue union, me restait ce besoin, partagé avec tant d’autres, proches ou inconnus, écrivains ou gens sans langage, d’ouvrir en grand les portes et les fenêtres. A la mort de ma femme, nous vécurent ensemble quarante ans, ce n’est pas rien, je me suis considéré comme fini, rayé des cartes. Décoloré. Sans le moindre relais. Ma vie a pris une couleur monochrome. Réduite. En panne. Celle des fonds des grandes toiles d’un bleu gris de Yan Pei- Ming vues l’autre jour au Palais des Papes en Avignon m’ont touché. Il sait peindre l’émotion et le tragique, sans pathos. Je tiens à ce signe d’intensité pauvre, celle de nos arrières plans est la plus loquace. Nos vies s’amarrent à ces pontons. La mienne d’un coup s’arrêtait. Après l’inhumation une interminable quarantaine relayée par deux longs mois de neige s’en est suivi. L’hiver quand il arrive semble être définitif. Je ne voyais pratiquement personne. J’ai saisi assez rapidement combien les semaines puis les mois allaient autrement compter. La semaison était rentrée, le vent mauvais avait couché les hautes gerbes. Notre grain le plus intime avait pris l’eau. La nuit, le jour, à toute heure, en mangeant, en bricolant, en me rasant vite et mal, en dormant mal et peu, je l’espérais. A trop faire du sur place, il me fallut intuitivement bouger. Je me suis mis à ranger tout ce que je pouvais atteindre, comme d’autres pleurent, se tassent ou se crispent, les papiers, les meubles, les pièces, les abords de la maison, le jardin et maintenant avec application les innombrables rangées de livres. Il me fallait fatiguer la douleur et l’inanité de ta perte. Chacun invente son espace de consolation. Les plus dérisoires intentions sont souvent les plus justes. J’ai décidé hier par bravade et par une réaction plus que jamais nécessaire de m’isoler de façon constructive, me démenant sous le toit, au moins le temps qu’il faudra pour reclasser et interroger dans les combles les restes de notre bibliothèque commune. La part compulsive de chacun est un surgeon de vie. L’une des traces majeures de notre passage en dehors de la restauration didactique de cette ancienne ferme niche donc à l’étage. Elle me semble disparate et si mal éclairée qu’on ne peut rien trouver sans être obligé de secouer l’ensemble. Il me faut deux heures pour tomber sur un livre que cherche. Au vrai je n’en cherche plus car, la tête ailleurs, je n’arrive plus à lire. Je dois réagir, poser des jalons, devenir l’arpenteur d’un terrain chamboulé. Les livres ont trop comptés pour nous pour que je les laisse en plan. Mon présent immédiat, âpre et suspendu reste bloqué à leur nombre. Il sombre dans l’ordinaire, cette bibliothèque se perpétue dans un égarement. Elle est passée au rang d’un simple tas de livres. Un fatras. Une brassée de bois mort. Il n’y a pas un jour à perdre si je veux la sauver. Nous sauver et replacer ton image en une juste proportion. Je suis entre deux étagements, sans accroche sociale, sans concession, sans vrai dialogue, étant réduit à la retraite à n’être qu’un accompagnateur de tes marges. Un orant immobile. Je prends des leçons de maintien en marchant. Cela va bien me tenir une longue semaine pour dégager des lignes de force. J’y logerais en partie notre récit de vie, nos échanges puis quelques unes de nos douces variantes. Ainsi tu reviendras. On a depuis si longtemps habités chez nos livres en locataires de l’espace qu’ils nous allouaient. Des avancées soudaines me confortent. Une semaine au milieu d’un tel chagrin, ce n’est rien. Le pire est arrivé, maintenant je ravaude. Je fus si souvent contenu dans tes gestes, dans leurs remuements, mettre un peu d’ordre m’aidera à nous continuer. Décider à mon tour, ranger comme tu le faisais ton petit monde, me prendre enfin en charge redessinera d’autres pas dans la neige, une trace nécessaire et une trêve visible. Je suis né de notre rencontre il y a si longtemps. Aller seul est nouveau. Je n’ai rien d’autre à faire qu’à reprendre tes comportements à mon compte. J’ai ta ligne d’horizon calée droit sous les tempes. « La paix reviendra par là » me suis-je dis avec raison. Imitons-là. A agir ainsi je me sens moins seul. Je reste condamné au récit élégiaque. A la suavité des douleurs sensibles. Au poème clos sur lui-même. A retremper un même linge dans la même bassine, je suis devenu la vieille femme, penchée sur le lavoir qu’on singeait autrefois. Le Royaume est circulaire.
La Bibliothèque gelée
Ces pages évoquent le temps, instable et friable, qui suit la disparition d’un être cher, une femme. La bibliothèque réveille sa présence, ravive ses traces. Les livres sont là, mais comme en suspens. Ils disent son absence. Que reste-t-il de l’être aimé ? La question leur est posée.
Ce récit rend à mots comptés la méditation équivoque d’un grand lecteur, son désarroi ou sa méprise. Il ouvre sur un au-delà de la perte. Une vérité plus dense.
C’est une histoire d’amour authentique qui transcende la maladie et le temps, qui rappelle la puissance des liens profonds et des passions longuement partagées.
Patrick Cloux signe ici un roman émouvant sur le deuil, qui met en contraste la courte temporalité d’une vie de couple face à l’intemporalité de la Littérature.
Auteur d’une vingtaine de livres, notamment Au grand comptoir des Halles, aux éditions Actes Sud, ou encore Un domaine sous le vent, aux éditions La Table Ronde, Patrick Cloux a obtenu le prix Marianne 2023 pour Trois Ruches bleues aux éditions La Fosse aux ours.
___________________________________
Format : 14×20,5
Nombre de pages : 104 pages
ISBN : 978-2-84418-472-6
16,00 €
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Auteur |
Cloux Patrick |
| Éditeur |
Collection Un Monde à Parts |