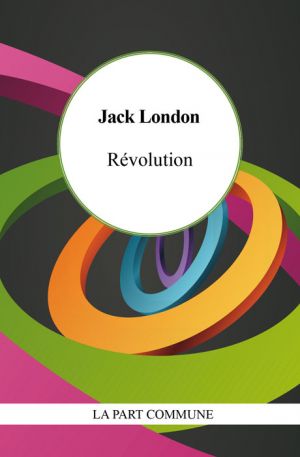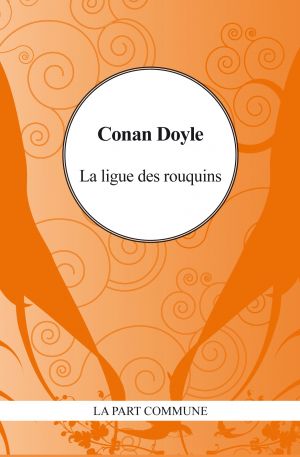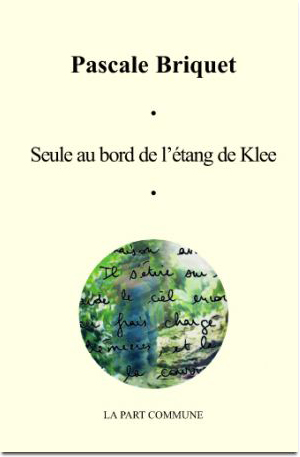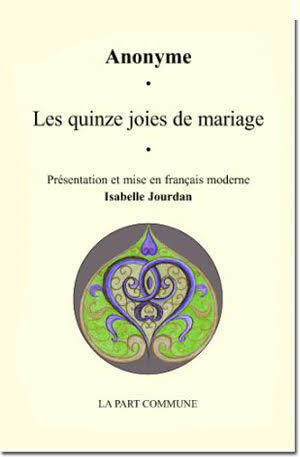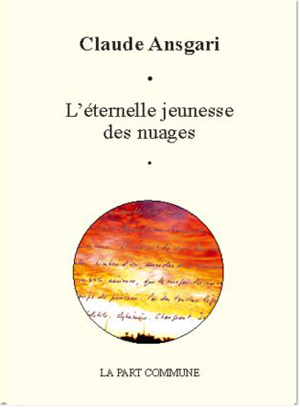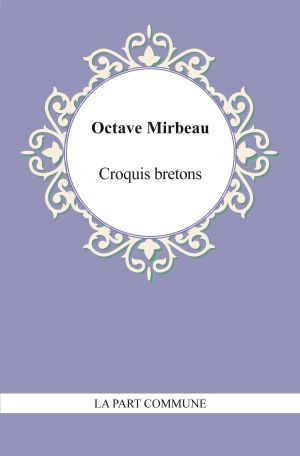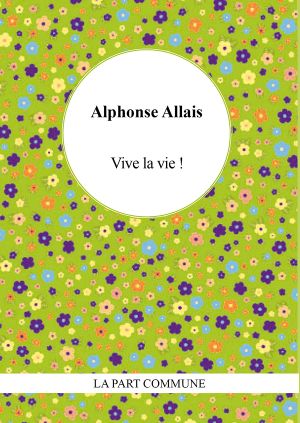ENTRETIENS
DE SCIPION ET DE BERGANCE
Chiens de l’Hôpital de la Résurrection
de Valladolid, qu’on appelle communément
les Chiens de Mahudès.
Scipion : Bergance, mon cher ami, cette nuit, nous avons abandonné la garde de cette maison et nous voici dans cet endroit isolé où nous allons pouvoir parler sans témoins. Puisque nous avons l’usage de la parole, profitons de cette faveur que le Ciel nous a accordée.
Bergance : Je t’entends parler, Scipion, et je sais que je parle moi aussi, mais j’ai bien du mal à le croire, tant la chose me paraît extraordinaire.
Scipion : Certes, il s’agit bel et bien d’un miracle, d’autant plus que non seulement nous parlons, mais que nous raisonnons également ; il n’en demeure pas moins qu’il n’y a que l’homme qui soit un animal raisonnable.
Bergance : J’entends, mon cher Scipion, tout ce que tu me dis, et quand je me fais la réflexion que je t’entends, je reste émerveillé par ta métamorphose et par la mienne. J’avoue que nous possédons un instinct admirable, mais l’instinct n’est pas la raison.
Scipion : Oui, Bergance, notre instinct est quelque chose qui surprend et occupe les plus sages d’entre les hommes. Nous avons de la mémoire, les hommes ne sauraient en disconvenir, nous avons de la reconnaissance, un attachement si fort, une fidélité si indéfectible qu’on a accoutumé de nous décrire comme les symboles de l’attachement et de la fidélité. N’es-tu jamais entré dans une église ? N’as-tu jamais posé les yeux sur ces superbes mausolées de porphyre et de marbre où les hommes se font ensevelir ? Tu te seras aperçu que lorsque le mari et la femme sont enfermés dans le même tombeau, il y a toujours la figure d’un chien à leurs pieds, pour indiquer que ce mari et cette femme, dont on peut voir la représentation, se sont témoigné toute leur vie un amour fidèle et inviolable.
Bergance : Je m’en suis aperçu très souvent. Je sais d’ailleurs qu’il y a eu des chiens si fidèles qu’ils se sont jetés dans le tombeau où leurs maîtres étaient enterrés. Je sais qu’il s’en est trouvé d’autres qui se sont laissés mourir de tristesse sur ces mêmes tombeaux, sans qu’il ait été possible de les en déloger, ni de les obliger à se nourrir. Je sais enfin qu’après les éléphants, nous sommes les animaux les plus intelligents, mais cette intelligence n’est rien en comparaison de celle des hommes.
Scipion : J’en conviens. Toujours est-il que nous raisonnons aujourd’hui, comme tu peux le constater, et puisque force nous est de convenir que cela n’a rien de naturel, tenons-le pour un prodige. Or, s’il s’agit d’un prodige, le monde est menacé de quelque calamité extraordinaire, car il n’y a jamais eu plus grand prodige.
Bergance : Je sais bien qu’on dit des prodiges qu’on ne les voit jamais impunément, et ce qui me confirme que celui-ci ne présage rien de bon pour les hommes, c’est un propos que j’ai ouï dire, il y a deux ou trois jours, par un écolier en passant par Alcala de Henares.
Scipion : Qu’a-t-il donc dit ?
Bergance : Voici ce dont il s’agit : sur cinq mille écoliers qui suivent des cours cette année dans cette Université, il y en a trois mille qui étudient la médecine.
Scipion : Que veux-tu dire par là ?
Bergance : Je veux dire qu’il n’y a forcément pas d’autre alternative : ou bien ces trois mille médecins auront des malades en proportion, ce qui sera un grand malheur pour le genre humain, ou bien ils mourront eux-mêmes de faim. Mais il semble que nous déployons trop d’énergie à nous tourmenter au sujet d’un avenir que nous ne saurions empêcher : ce qui doit arriver arrivera, car ce que le Destin a décidé est irrévocable.
Scipion : Tu as raison, Bergance, si ce qui nous arrive aujourd’hui présage de grands malheurs pour les hommes, ce sont des malheurs que nous ne saurions empêcher. Il vaut donc mieux que, tout en laissant les événements entre les mains de celui qui en est le maître et sans chercher à savoir à quel décret secret de la Providence nous devons l’usage de la parole, nous profitions pendant cette nuit de cet agréable privilège, car nous ne savons pas si nous en jouirons longtemps.
Bergance : Bien parlé, mon cher Scipion, et j’apprécie tout particulièrement ce privilège. Depuis que j’ai la force de ronger un os, j’ai toujours eu envie de parler pour me décharger d’une infinité de choses que j’ai vues et entendues, et qui méritent d’être racontées. Je crois comme toi que ce privilège de pouvoir communiquer ce que nous savons, dont nous jouissons en cet instant, n’est que passager, sinon il ne s’agirait plus d’un prodige ; n’attendons pas que celui qui nous a fait un si riche présent nous le retire : parlons Scipion, puisque nous en avons la faculté en ce moment.
Scipion : Je suis ravi, Bergance, de te voir partager mes sentiments sur ce point. Eh bien, puisque tu as tant de choses à me dire, parle, je t’écouterai. Raconte-moi tes aventures et si demain soir il nous est permis de parler encore, je te raconterai les miennes.
Bergance : Je suis d’accord, mais vérifions au préalable que l’on ne puisse pas nous entendre.
Scipion : Il n’y a personne, tout le monde dort. C’est vrai qu’il y a un soldat dans ce lit, qui prend des suées depuis pas mal de temps, mais m’est avis que ça le fatigue tellement de transpirer que je suis certain qu’il se repose, et j’en suis d’autant plus sûr que je l’entends ronfler.
Bergance : Puisque je puis parler en toute sécurité, écoute-moi et si ce que j’ai à dire t’ennuie, tu n’as qu’à m’imposer le silence.
Scipion : Parle, mon cher ami, je serai tout oreilles, quand bien même tu parlerais jusqu’à demain.
Bergance : Pour commencer par mes origines, je te dirai que la première fois que j’ai vu le Soleil, c’était à Séville, dans la boucherie qui est hors les murs ; ce qui me laisse penser qu’il est possible que je descende de ces gros mâtins que nourrissent les valets des bouchers, même si j’ai un autre point de vue, que je te révélerai à une autre occasion. Le premier maître que j’ai eu était un boucher appelé Maître Nicolas. C’était un jeune homme fort et robuste, au visage mal fait, colérique et vindicatif comme le sont généralement ceux de ce métier. La première chose que Maître Nicolas m’a enseigné, ainsi qu’à d’autres jeunes chiots, ce fut d’aboyer contre les passants, en particulier contre les pauvres, et de les poursuivre impitoyablement. Lorsqu’il y avait des combats de taureaux, il nous jetait au milieu des dogues, afin que nous les imitions : il nous excitait de la voix et de la main munie d’un bâton, et j’avoue que, quoique bien souvent je n’aie pas trouvé mon compte dans ces escarmouches, je devins rapidement si agile que le plus gros taureau ne me faisait pas peur ; et pour ce qui est des passants et des pauvres, je puis affirmer qu’ils me craignaient : en très peu de temps, je suis devenu étonnamment hardi et hargneux.
Scipion : Cela semble te surprendre, Bergance, mais pas moi. Il n’y avait sans doute rien de pire que ce que ton maître t’a appris à cette époque. Mais sache que rien ne s’apprend plus facilement que le mal : notre nature nous y porte, nous naissons avec ce malheureux penchant.