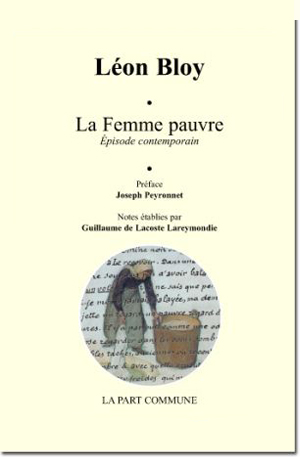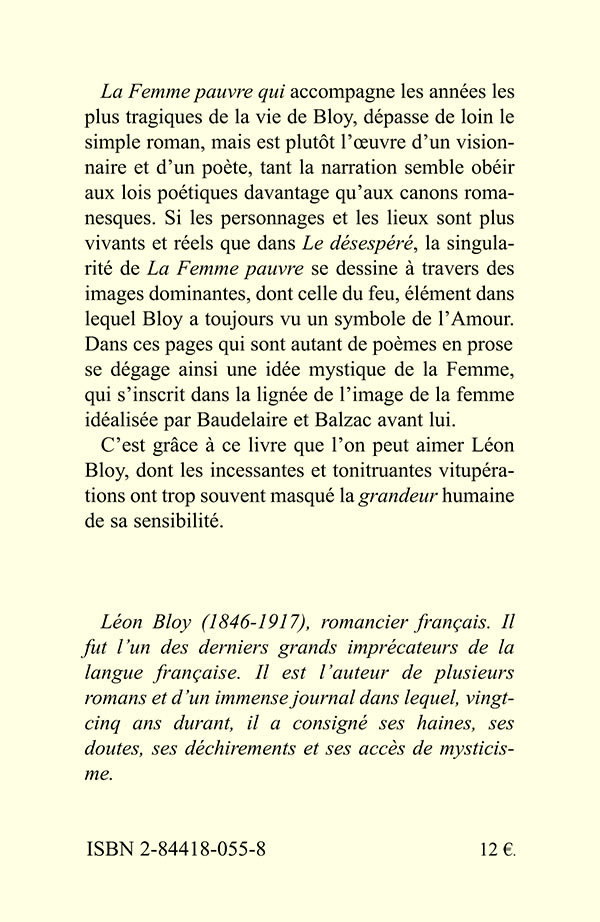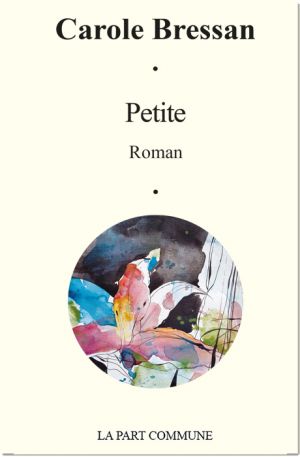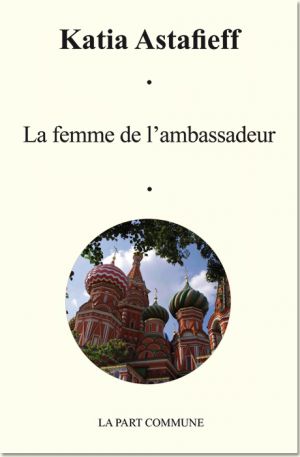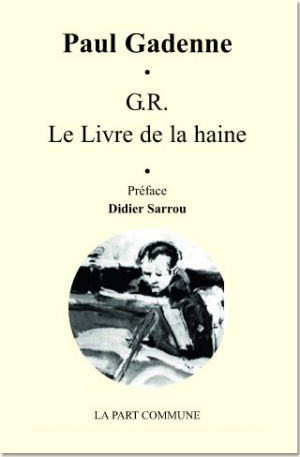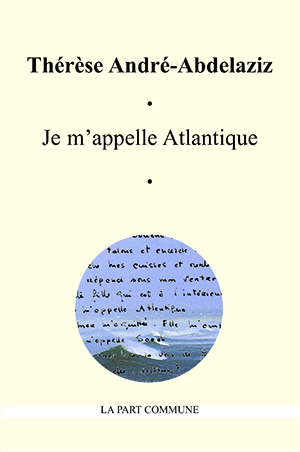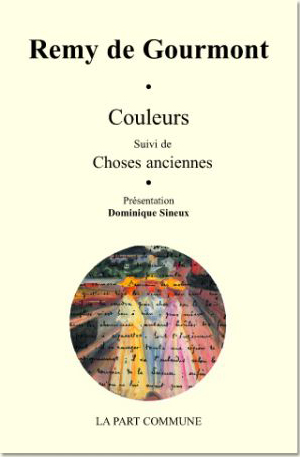– ça pue le bon Dieu, ici !
Cette insolence de voyou fut dégorgée, comme un vomissement, sur le seuil très humble de la chapelle des Missionnaires Lazaristes de la rue de Sèvres, en 1879.
On était au premier dimanche de l’Avent, et l’humanité parisienne s’acheminait besogneusement au Grand Hiver.
Cette année, pareille à tant d’autres, n’avait pas été l’année de la Fin du monde et nul ne songeait à s’en étonner.
Le Père Isidore Chapuis, balancier-ajusteur de son état et l’un des soulographes les plus estimés du Gros-Caillou, s’en étonnait moins que personne.
Par tempérament et par culture, il appartenait à l’élite de cette superfine crapule qui n’est observable qu’à Paris et que ne peut égaler la fripouillerie d’aucun autre peuple sublunaire.
Crapule végétale des moins fécondes, il est vrai, malgré le labour politique le plus assidu et l’irrigation littéraire la plus attentive. Alors même qu’il pleut du sang, on y voit éclore peu d’individus extraordinaires.
Le vieux balancier, qui venait d’entrouvir la crapaudière de son âme en passant devant un lieu saint, représentait, non sans orgueil, tous les virtuoses braillards et vilipendeurs du groupe social où se déversent perpétuellement, comme dans un puisard mitoyen, les relavures intellectuelles du bourgeois et les suffocantes immondices de l’ouvrier.
Très satisfait de son mot, dont quelques dévotes, qui l’examinèrent avec horreur, s’étaient effarées, il allait, d’un pas circonflexe, vers une destination peu certaine, à la façon d’un somnambule que menacerait le mal de mer.
Il y avait comme un pressentiment de vertige sur ce mufle de basse canaille couperosé par l’alcool et tordu au cabestan des concupiscences les plus ordurières.
Une gouaillerie morose et superbe s’étalait sur ce mascaron de gémonies, crispant la lèvre inférieure sous les créneaux empoisonnés d’une abominable gueule, abaissant les deux commissures jusqu’au plus profond des ornières argileuses ou crétacées dont la litharge et le rogomme avaient raviné sa face.
Au centre s’acclimatait, depuis soixante ans, un nez judaïque d’usurier ponctuel où se fourvoyait, le chien-dent d’une séditieuse moustache qu’il eût été profitable d’utiliser pour l’étrillage des roussins galeux.
Les yeux au poinçon, d’une petitesse invraisemblable et d’une vivacité de gerboise ou de surmulot, suggéraient, par leur froide scintillation sans lumière, l’idée d’un nocturne spoliateur du tronc des pauvres, accoutumé à dévaliser les églises.
Enfin l’aspect de ce ruffian démantibulé donnait l’ensemble d’un avorton implacable, méticuleux et présent jusque dans l’ivresse, que d’anciennes aventures auraient échaudé et qui, dès longtemps, n’avivait plus son cœur de goujat qu’à l’assaut des faibles et des désarmés.
Il n’était pas absolument sans lettres, cet excellent père Chapuis. Il lisait couramment des feuilles arbitrales et décisives, telles que la Lanterne ou le Cri du peuple, croyant fort à l’avènement infaillible de la Sociale et bafouillant volontiers, dans les caboulots, de pâteux oracles sur la politique et la religion, ces deux sciences débonnaires et si prodigieusement faciles, – comme chacun sait, – que le premier galfâtre venu peut y exceller.
Quant à l’amour, il le dédaignait, sans phrases, le considérant négligeable, et si, d’aventure, quelque autre docteur y faisait la moindre allusion sérieuse, aussitôt il bouffonnait et pandiculait en s’esclaffant.
C’est pourquoi l’aimable Isidore assumait la considération d’un nombre incroyable de mastroquets.
On ne savait pas exactement ses origines, quoiqu’il s’affirmât d’extraction bourgeoise et périgourdine. Extraction lointaine, sans doute, puisque le drôle était né, disait-il lui-même, au faubourg du Temple, où ses parents avaient dû pratiquer de vagues négoces très parisiens sur lesquels il n’insistait pas.
Il se réclamait donc volontiers d’une ascendance provinciale digne de tous les respects et de collatéraux innombrables répartis au loin, dont il vantait les richesses, non sans flétrir avec énergie l’orgueil de propriétaires qui leur faisait méconnaître sa blouse glorieuse de citoyen travailleur. Effectivement, on n’en avait jamais vu un seul. Cette parenté problématique était ainsi, à la fois, une ressource de gloire et une occasion de déchaînements généreux.
Mais il se déchaînait encore plus contre l’injustice de sa propre destinée, racontant avec l’emphase des aborigènes méridionaux, la malchance damnée qui avait paralysé toutes ses entreprises et l’improbité fangeuse des concurrents qui l’avait réduit à quitter la redingote du patron pour la vareuse du prolétaire.
Car il avait été réellement capitaliste et chef d’atelier, travaillant à son compte, ou plutôt faisant travailler parfois une demi-douzaine d’ouvriers pour lesquels il parut être le commandeur des croyants de la ribote et de la vadrouille éternelle.
Le quartier de la Glacière se souvient encore de ces ajusteurs de rigolade, à l’équilibre litigieux, qu’on rencontrait chez tous les marchands de vins, où le singe, toujours ivre-mort, leur promulguait habituellement sa loi.
La déconfiture assez rapide, et suffisamment annoncée par de tels prodomes, n’étonna que Chapuis qui, d’abord, se répandit en imprécations contre la terre et les cieux et reconnut ensuite, avec une bonne foi de pochard, qu’il avait eu la bêtise d’être « trop honnête dans les affaires ».
Quant à la source désormais tarie de cette prospérité si éphémère, nul n’en savait rien. Un petit héritage de province, avait dit vaguement le balancier. Certains bruits étranges, cependant, avaient autrefois couru qui rendaient assez douteuse l’explication.
On se souvenait très bien d’avoir connu cette arsouille avant les deux sièges, entièrement dénuée de faste et trimbalant d’atelier en atelier sa carcasse rebutée de mauvais compagnon.
Subitement, après la Commune, on l’avait vu riche de quelques dizaines de mille francs, dont il avait acheté son fonds.
Si la sourde rumeur du quartier ne mentait pas, cet argent, ramassé dans quelque horrible cloaque sanglant, eût été la rançon d’un prince du négoce parisien inexplicablement préservé de la fusillade et de l’incendie, l’héroïque Chapuis ayant été comandant ou même lieutenant-colonel de fédérés.
La très mystérieuse et très arbitraire clémence, qui épargna certains facétieux à l’issue de l’insurrection, s’était étendue sur lui comme sur bien d’autres plus fameux qu’on savait ou supposait détenteurs de secrets ignobles et dont on pouvait craindre les révélations.
On le laissa donc tranquillement cuver son ivresse de naufrageur et il ne fut même pas inquiété, ayant eu l’art, d’ailleurs, de se rendre parfaitement invisible pendant la période des exécutions sommaires.
Un peu plus tard, deux ou trois tentatives d’interview, pratiquées par des reporters de l’ordre moral, ayant échoué d’une manière absolue devant l’abrutissement réel ou simulé de ce perpétuel ivrogne, on y renonça et le père Chapuis, un instant presque célèbre, réintégra pour jamais l’obscurité la plus profonde.
Il y avait ainsi sur cet homme tout un nuage de choses troubles qui lui donnait une importance d’oracle aux yeux des pauvres diables qu’il avait la condescendance de fréquenter et dont les âmes enfantines sont si aisément jugulées par tout aboyeur supposé malin. Le peuple souverain n’est-il pas devenu lui-même la Volaille sacrée des superstitions antiques pour les aruspices de cabaret dont la police, quelquefois, utilise volontiers la pénétration ?
Au résumé, le vieil Isidore avait la renommée d’un « sale bougre », expression générique dont la force ne sera pas contestée.
Il appartenait, sans aucun doute, à cette lignée idéale de chenapans que la Providence institua, dès l’origine, pour l’équilibre des Séraphins.
Ne fallait-il pas cette vase au fleuve de l’Humanité pour que le trouble et la puanteur de ses ondes pût l’avertir, lorsque quelque chose tomberait du ciel ? Et comment se pourrait-il qu’un cœur fût grand sans l’éducation merveilleuse de cet inévitable dégoût ?