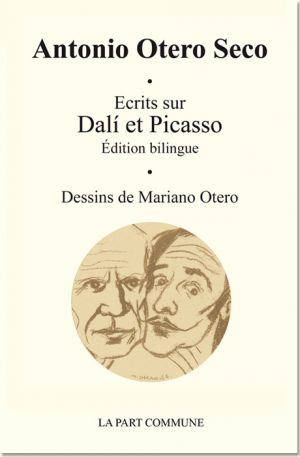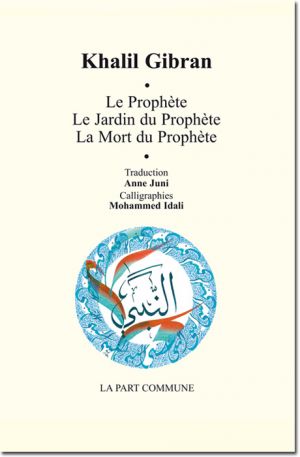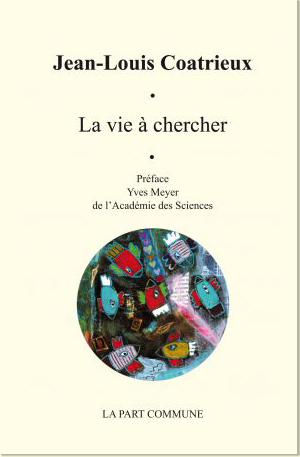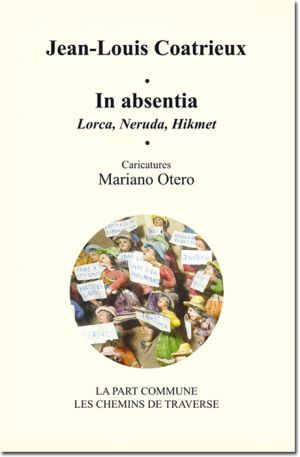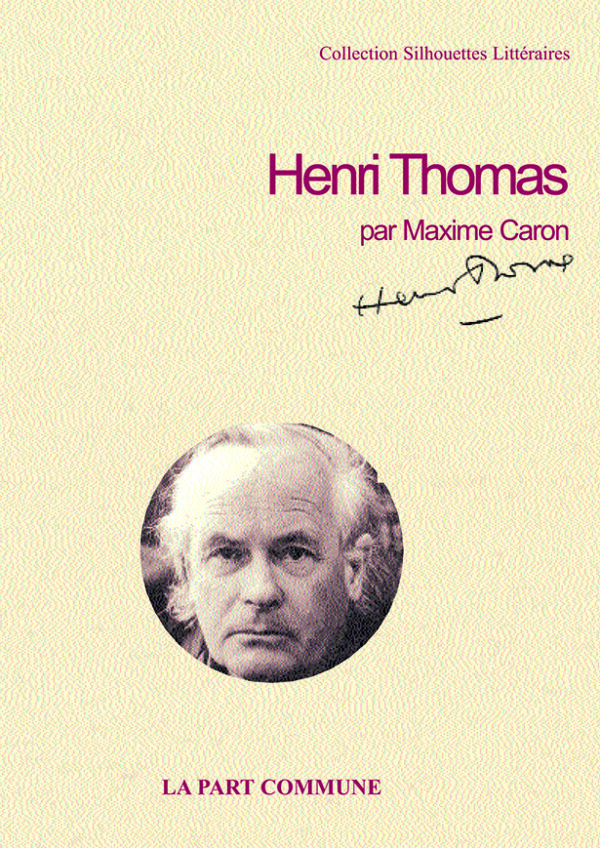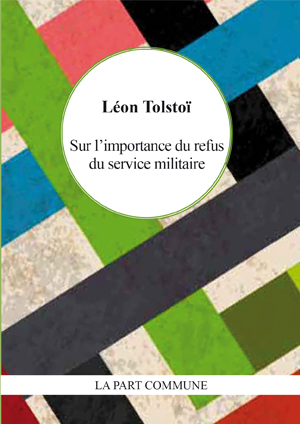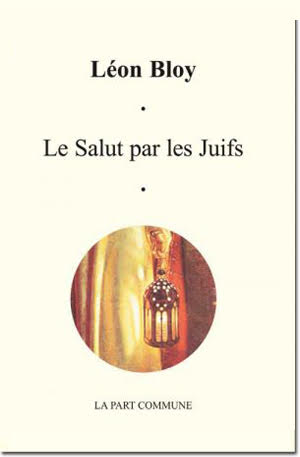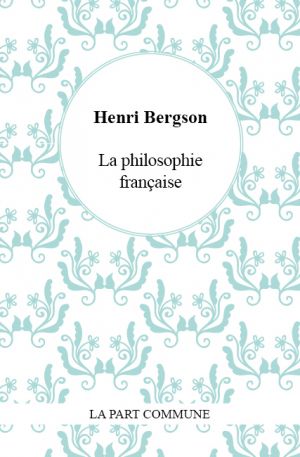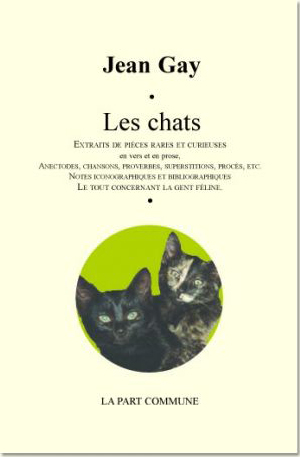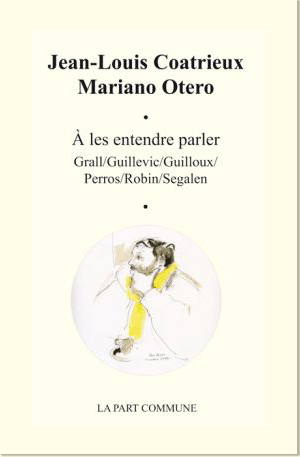ou du moins c’est comme ça
que moi je le voyais
Je me propose de parler d’Antonio Otero Seco. Et d’en dire du bien, car il m’est impossible de faire autrement. Je sais parfaitement que, d’un point de vue juridique, je suis récusable car je tombe entièrement sous le coup des considérations générales de la Loi. Comme une affinité et une amitié fraternelle me liaient à lui, la Loi prétend que je ne peux être objectif. Mais, si cette récusation, aux yeux de la Loi, est recevable, elle ne l’est pas au regard de ces lignes car nul n’est plus indiqué pour parler d’une personne que cette autre qui l’a intimement connue. Et c’est justement mon cas. Je vais donc parler d’Antonio Otero Seco, non pas pour en faire le panégyrique mais pour le présenter à travers certains aspects de sa vie.
Antonio Otero Seco et moi-même avons été frères d’armes. Ce que je veux dire par là, reprenant la façon dont on s’exprimait dans certains villages de Castille, c’est que nous étions de la même conscription. Ou, ce qui revient au même, que nous étions de la même classe. Mais à l’époque où lui « marchait au pas » en terres andalouses – à Séville ou Cordoue, je crois – et que moi je le faisais en terres catalanes – plus précisément à Barcelone – nous ne nous connaissions pas. Ce n’est que plusieurs années plus tard que nous nous sommes vus pour la première fois. Où ? Je ne me souviens pas de l’endroit exact mais je ne me tromperai pas de beaucoup si je dis que ça a dû se passer dans l’une de ces nombreuses tertulias littéraires qui existaient alors dans la capitale espagnole : La Granja, Negresco, El Colonial, El Universal, El María Cristina, El Gato Negro, El Castilla… ou, peut-être au Bureau de Presse de la Telefónica situé alors au début de la rue d’Alcalá, là où s’élève aujourd’hui un édifice appartenant à la Caisse d’Épargne. Ce Bureau de Presse est un agréable souvenir pour tous les journalistes de cette époque-là parce qu’ils s’y côtoyaient sans distinction de nuances politiques, si tant est qu’elles existaient, puisqu’appartenir à la rédaction d’un journal d’une idéologie déterminée ne supposait pas que le rédacteur y souscrive et encore moins que pour cette raison il évite ses collègues. Bien au contraire, il se joignait à eux et discutait échangeant les nouvelles, exception faite, naturellement, de celles qui étaient ou pouvaient être un « scoop », c’est-à-dire que l’on supposait être une exclusivité – même si le plus souvent ce n’en était pas une, mais qui, lorsque c’était le cas, constituait un coup de maître que, dans la profession, on ne pouvait pas laisser passer. En ce temps-là, si on appartenait à un journal sérieux – El Sol – on pouvait traiter d’« abbés parfumés » ceux qui travaillaient pour El Debate et de « moines sauvages » les rédacteurs de El Siglo Futuro et, si l’on appartenait à ces derniers traiter les autres de « huguenots » ou quelque chose d’approchant sans que cela dérangeât quiconque le moins du monde ni impliquât un manquement à l’amitié, la cordialité et la camaraderie.
Antonio était un infatigable et agréable causeur. Quand il conversait, sans s’écouter parler, ce qui était l’une de ses qualités, il oubliait tout : un rendez-vous fixé au préalable, l’heure du repas et même celle d’aller toucher sa paie quand cela se présentait, c’est-à-dire pas très souvent. La conversation lui était nécessaire, indispensable ; on peut aller jusqu’à dire que c’était là sa vraie vie car il donnait ainsi libre cours à sa fantaisie et à ses projets, qui étaient nombreux. Je peux l’affirmer parce que j’ai souvent été son interlocuteur. Comme nous habitions très près l’un de l’autre, nous prenions ensemble le chemin du retour. Et, tout en discutant, nous arrivions devant chez l’un de nous. Alors, celui qui habitait là, disait : « Je t’accompagne un peu. » Et quand nous arrivions chez l’autre, on entendait à nouveau : « Je te raccompagne. » On refaisait ainsi plusieurs fois le chemin, discutant de tout : des derniers potins, de journalisme, de musique, de poésie… surtout de poésie. Combien de fois, lors de ces promenades, ne m’a-t-il pas récité les siennes !
Et il n’était pas rare que, conversant et marchant, nous voyions le jour se lever et qu’alors moi, qui étais le plus réaliste, forçant un peu la note je lui dise :
– Bon, restons-en là parce que, si on continue comme ça, la nuit pourrait bien nous surprendre.
Antonio et moi-même, rejoints par d’autres amis, avons arpenté tout Madrid minutieusement. On pouvait même dire que l’on connaissait la ville mieux que bon nombre de Madrilènes qui se vantaient de bien la connaître. À l’image de ce que proposent aujourd’hui certains organismes culturels, nos promenades suivaient un objectif précis. On visitait le vieux Madrid, qui mérite tant d’être vu, déambulant dans ses rues étroites, ses ruelles et passages afin de rappeler certains faits qui avaient eu lieu là, essayant de localiser l’endroit exact. Il va sans dire que Escobedo, Villamediana, la Princesse d’Éboli, Antonio Pérez, etc., étaient de ces personnages qui guidaient nos itinéraires romantiques parfois en compagnie de la lune qui leur donnait plus d’éclat, même si ce n’était pas prémédité.
Parfois, la personne dont on suivait la trace appartenait à une catégorie nettement inférieure, comme par exemple : Luis Candelas, ce voleur professionnel, sans doute en avance sur son temps, idéalisé dans les romances. On parcourait la rue du Calvario, où était né Candelas, afin de localiser l’endroit où se situait la menuiserie de son père ; les rues de Tudescos et de la Estrella afin de voir ces maisons donnant sur deux rues qui étaient si utiles pour ses affaires, la rue Imperial où se situait la taverne de « el Cuclillo », contrebandier à la retraite, où se réunissait la bande, etc. etc.